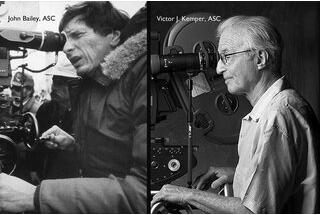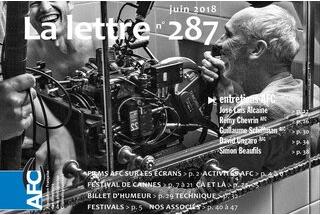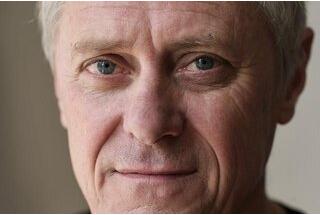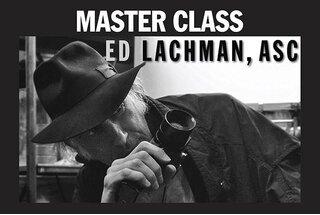Le chef opérateur Balthazar Lab parle de ses choix visuels sur "La Jauría", d’Andrés Ramírez Pulido
Balthazar Lab : C’est un film franco-colombien. La production française cherchait un chef opérateur français. J’ai fait un Skype avec le réalisateur, Andrés Ramírez Pulido. Je parlais en anglais, mais il ne comprenait pas grand chose et lui me parlait en espagnol, et je ne comprenais pas grand chose non plus ! On a eu une conversation assez surréaliste et je me suis dit que je n’allais jamais faire ce film, c’était trop abstrait. Deux jours plus tard, la production m’a appelé, me disant que Andrés avait envie de travailler avec moi. J’avais vraiment des doutes sur la pertinence de cette idée ! J’ai réfléchi, le scénario était extrêmement prometteur, il m’avait beaucoup touché. J’ai téléchargé une application pour apprendre l’espagnol sur mon téléphone et je me suis mis à faire ça de manière intensive en attendant mon départ pour la Colombie.

Avec cette difficulté à communiquer, on a mis en place une autre forme de langage pendant la préparation à base de références, de dessins, de mots-clefs, et finalement on a quand même fait une préparation très solide. Les plans étaient pensés en termes d’intention. Andrés a une culture cinématographique extrêmement importante, c’est pour ça que notre dialogue était assez précis en termes de références.
Rétrospectivement, je me dis que cette barrière de la langue, qui semblait assez définitive lors du premier entretien, était presque une bonne chose. On ne s’est pas perdu dans des problématiques de formulation, on en vient à parler de choses extrêmement concrètes, on est obligés de se concentrer sur une forme hyper pure de langage, qui est vraiment : distance et hauteur caméra, mouvement. Ne pas être encombrés par le langage, ça nous a permis de nous concentrer sur ce qui est essentiel.
Ibagué était notre point de départ, une ville moyenne du centre de la Colombie qui est dans une zone à la fois montagneuse et forestière. On y a fait six semaines très intensives de préparation, quasiment H24 dans des discussions, des problématiques de décors, de lieux.
Le découpage a été très préparé avec quelques idées-clefs, comme celle des plans circulaires. Au final, au montage, il n’en reste qu’un mais qui est vraiment fort. Il y a un gros travail sur la hauteur de la caméra qui n’est jamais vraiment à l’endroit où on l’aurait mise d’une manière standard. On avait l’idée d’une caméra toujours assez haute. C’était une des volontés d’écriture du film, qu’on a formulée explicitement en préparation et qui nous a guidés ensuite. C’est une manière de faire ressentir à quel point nos personnages sont dans un moment de fragilité et d’écrasement par l’institution dans laquelle ils sont.
On avait en commun avec Andrés un grand amour pour le premier film de Ruben Östlund, Play. C’est un film sur des enfants également, avec un travail très pur de distances à la caméra, de durée des plans, et une forme d’ascétisme, une exigence de mise en scène, de simplicité qui laissent la place aux interprètes. C’est une référence qui nous a beaucoup intéressés.
Il n’y a pas beaucoup de gros plans dans le film. Le seul très gros plan est pendant la soirée, et c’est le moment où le personnage fait un choix important. On avait le sentiment, pour ce film, que le gros plan était une carte magique qu’on ne voulait jouer qu’à certains moments-clés du film. Le début du film est plus focalisé sur les corps, et la fin se resserre pour être vraiment dans la tête du personnage principal. Je devais avoir en tête Cemetary of Splendor, d’Apichatpong Weerasethakul, le dernier plan est le seul plan rapproché du film, et tout a coup il y a quelque chose de fort qui se fabrique à cet endroit-là.

Les acteurs n’avaient pas le scénario. A la répétition, les scènes sont mises en place, ils jouent ensemble, et Andrés va donner des indications et modifier des choses. Il avait l’intuition qu’avec un zoom on allait pouvoir rapidement se rapprocher, changer des choses, s’adapter aux improvisations des acteurs.
Le mot zoom avait été évoqué très tôt, lors du premier Skype, c’était un des mots-clés. J’avais déjà utilisé ce vieil Angénieux 25-250 mm sur un clip que j’avais fait à Paris, et je l’avais trouvé très beau avec toutes ses aberrations, sa douceur. J’étais heureux de voir qu’il y en avait un en Colombie, 80 % du film est fait avec ce zoom. On avait une série d’Ultra Prime pour certaines séquences de nuit et quand il y avait un problème d’encombrement. On a très rapidement eu une grande affection pour ce zoom et il a vraiment contribué avec nos options d’étalonnage à forger une esthétique singulière pour ce film qui fut définie précisément dès la fin des essais esthétiques.
On a tourné avec une RED Gemini. On avait beaucoup de scènes de forêt de nuit et des moyens de lumière qui allaient être limités. Le dual ISO était vraiment une option intéressante, surtout avec ce zoom très peu lumineux qui ouvre autour de 4. Dans les RED, la Gemini est probablement celle qui m’intéresse le plus parce qu’elle a des photosites un peu plus grands. C’était finalement une très belle surprise. Très vite on a trouvé une matière qui nous plaisait. C’était, pour moi, une nouveauté de l’utiliser mais dès les essais on s’est dit qu’on était à l’aise avec.
Le capteur de la Gemini est beaucoup plus grand que du Super 35. Je trouve que c’est un peu étonnant de sortir des standards cinématographiques en termes de taille de capteur mais là, ça nous a permis de maximiser les aberrations du zoom, parce qu’on prenait vraiment à la limite de couverture du zoom, et plus on s’éloigne du centre plus les aberrations sont énormes. Ça a été vraiment une discussion en étalonnage pour savoir à quel endroit on mettait le niveau d’acceptabilité du vignettage. On s’est posé la question de savoir s’il contribue au sentiment d’enfermement. Il y a eu des passes entières du film à regarder le vignettage, savoir s’il était trop fort, s’il fallait cropper un peu, le diminuer ou laisser tel quel.
On a longtemps hésité sur le ratio. On en a essayé plusieurs et ça a été une discussion quasiment jusqu’au dernier jour de préparation. Le 1,66:1 nous semblait finalement assez juste dans le rapport à ce groupe d’enfants, dans un format plus carré qui donne plus de place pour les corps.
La Colombie est quasiment à l’équateur. Le soleil fait une ligne droite dans le ciel, il est rapidement très haut, au bout d’une heure après le lever, il est même plus haut qu’un soleil d’hiver à midi en France. Il passe à l’aplomb parfait et on ne peut pas tourner très longtemps au soleil parce qu’il est vraiment très puissant. Dans le film, il y a ces moments de peau un peu brûlée par le soleil, et des moments où on essaye d’avoir l’ombre la plus forte car chaque impact de rayon de lumière fait exploser le capteur. Les contrastes sont très très forts. Je me souviens la première fois que j’ai sorti SunSeeker, l’application qui permet de voir le soleil, j’ai regardé comment ça allait être dans deux ou trois mois au moment de tourner, c’était toujours pareil ! J’ai fait le tour de l’année, toujours pareil. Toujours une ligne droite dans le ciel. C’est impressionnant.
On s’est retrouvés souvent avec de grands cadres ou des tissus blancs posés dans le décor pour essayer de ré-équilibrer le contraste extrêmement puissant que provoque ce soleil. Les nuits sont assez ré-éclairées, pour équilibrer les torches et éviter de perdre de la matière dans les flammes. Heureusement j’avais un gaffer vraiment incroyable, Giovanni Barrios, qui était le gaffer de Memoria, qui a réussi à trouver plein de solutions, notamment une capacité incroyable à accrocher des sources dans les arbres, parfois à 30 mètres de haut ! Il arrive à faire passer des cordes et à accrocher des trucs à des endroits incroyables ! Ça a été un plaisir de travailler avec lui, une collaboration vraiment précieuse.
On avait ce faisceau de lumière dans la grotte qui était écrit et perçu dès le scénario comme touchant au sacré. A quel point un rayon de lumière peut toucher, et touche le personnage. C’était notre première journée de tournage, dans un décor complètement inaccessible. J’ai demandé à mon équipe lumière de ramener un Maxi Brute à plusieurs centaines de mètres des camions, avec le groupe électrogène, au milieu de la jungle, et d’accrocher un miroir en déport au-dessus d’un trou qui donnait sur la grotte pour pouvoir faire rebondir ce projecteur sur le miroir... C’était un vrai challenge, car le trou laissait passer une cascade, donc on a dû détourner la rivière pour cette séquence !
La séquence de la fête était aussi un moment étonnant en termes de dispositif de lumière. Notre idée avec Andrés était de faire de ce lieu un lieu un peu infernal. Ce sont les deux moments qui touchent d’un côté au divin et de l’autre côté à l’enfer, et qui partent dans des choses complètement expressionnistes.
Le plan-séquence, entre chien et loup au bord de la piscine, a été une grande guerre. La production colombienne avait peur de ce plan. C’est un mineur qui est jeté dans la piscine, ils avaient peur de toutes les problématiques de sécurité. L’acteur devait jouer la noyade et on avait tous conscience de ce que ça voulait dire. Les acteurs ne savaient pas bien nager donc, dès la préparation, il devait aller régulièrement à la piscine pour être à l’aise avec l’eau ; on a essayé de trouver une option de doublage, etc. Ça me tenait extrêmement à cœur de le faire en plan-séquence. Au final, on a pris deux soirées pour faire ce plan. Ça a été un moment d’intensité du tournage extrêmement puissant. Ce plan synthétisait un des grands enjeux du film : la violence ; la ressentir sans être complaisants.
Je pense qu’une force incroyable du travail d’Andrés, c’est d’être extrêmement aux prises avec les problématiques de la Colombie actuelle. C’est incroyable à quel point le film est proche de la violence endémique qui a complètement gangrené toute la société. Andrés a une grande sensibilité à ça, il a travaillé pendant des années avec des enfants issus de prisons ou de centres de réhabilitation pour jeunes mineurs délinquants. Tous les enfants qui jouent dans le film viennent de milieux difficiles, ont connu des situations d’enfermement. Il y a une fibre documentaire dans ce film vraiment très forte en termes de ressenti mais son intuition était qu’il fallait mettre en place un dispositif de fiction qui décale toute cette vérité dans un autre univers pour en faire un objet de cinéma plus singulier. Il y avait tous ces éléments de décors, de costumes et de caméra qui ramenaient le film vers une forme plus abstraite, plus métaphorique. La synthèse se fait en fabriquant, on arrive à un endroit qui fait parti de la proposition du film et qui le rend extrêmement singulier, c’est presque documentaire mais c’est puissamment fictionnel et singulier.
(Propos recueillis par Margot Cavret, pour l’AFC)
 En
En
 Fr
Fr