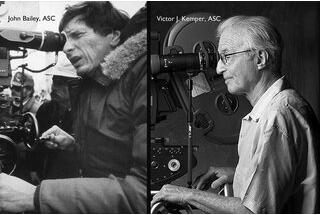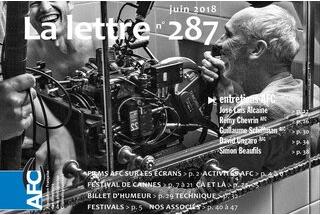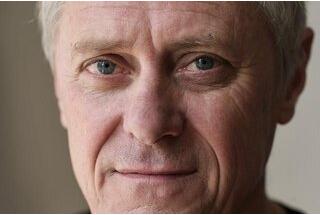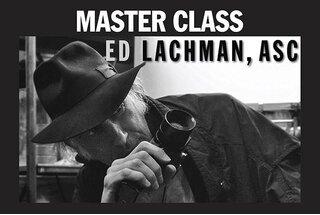Analyse
Cannes, la mort et l’amour du cinéma
par Jacques MandelbaumLe Monde, 28 mai 2007
Voilà longtemps qu’on n’avait pas vu au Festival de Cannes, qui a célébré cette année son soixantième anniversaire, une compétition aussi sombre, aussi inquiète, aussi requise, surtout, par l’épreuve de la mort et par l’interrogation métaphysique ou religieuse. S’en tiendrait-on aux seuls films de la compétition - on en compta vingt-deux, venus de douze pays et de trois continents - que le nombre des disparus et l’affliction qui les accompagne dépasseraient largement le seuil du supportable.
Passons rapidement sur la liste des cadavres nécessaires à la bonne santé du film de tueur en série. Ces morts-là vont vite, ils sont la loi du genre. Les frères Coen dans No Country for Old Men, Quentin Tarentino dans Boulevard de la mort et David Fincher dans Zodiac ont beau jeu de les aligner comme à la parade.
Partout ailleurs, la camarde va moins de soi. Elle touche les grands-pères (Promets-moi, du Serbe Emir Kusturica) et les grand-mères (Persepolis, de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud). Elle frappe sauvagement les pères et les maris (La Nuit nous appartient, de l’Américain James Gray, les foudroie par accident vasculaire (Le Scaphandre et le papillon, de l’Américain Julian Schnabel), les éclipse sans autre forme de procès (Tehilim, du Franco-Israélien Raphaël Nadjari).
Elle fauche par arrêt cardiaque des épouses et des mères (Lumière silencieuse, du Mexicain Carlos Reygadas, Le Bannissement, du Russe Andreï Zviaguintsev). Elle tarit par commotion cérébrale la sève des jeunes femmes (Les Chansons d’amour, du Français Christophe Honoré) ou les guérit de leur idéalisme d’un coup de feu (De l’autre côté, de l’Allemand Fatih Akin).
Elle n’épargne pas non plus les enfants (Secret Sunshine, du Coréen Lee Chang-dong, Une vieille maîtresse, de la Française Catherine Breillat, La Forêt de Mogari, de la Japonaise Naomi Kawase) et prend parfois les devants en avortant la vie naissante (4 mois, 3 semaines et 2 jours, du Roumain Cristian Mungiu, Le Bannissement, de Zviaguintsev). Elle élimine enfin des inconnus à l’aveuglette (Paranoid Park, de l’Américain Gus van Sant, L’Homme de Londres, du Hongrois Bela Tarr) ou se suspend lourdement sur le monde en souffrance des vivants (Alexandra, du Russe Alexandre Sokurov, Import Export, de l’Autrichien Ulrich Seidl, Souffle, de Kim Ki-duk).
Pour omniprésente et inexorable que soit l’existence de la mort, une telle accumulation en deux semaines de projections mérite réflexion. Comme il n’y pas lieu de croire qu’il ait été dans la volonté du Festival de Cannes de fêter son anniversaire en réconciliant inopinément pompe mondaine et pompes funèbres, deux hypothèses peuvent être évoquées. La première tient à la définition du cinéma comme miroir du monde. La mort nous environnant en permanence, il serait somme toute normal que le cinéma la reflète. Pour dire le vrai, on n’y croit pas trop, pour une simple raison de proportion : sauf circonstance exceptionnelle, la vraie vie ne nous confronte pas aussi fréquemment et intensément à la mort que ce qu’en laissent apparaître les films cannois. Reste donc à la considérer comme un motif par lequel le cinéma, art ancien désormais, se penche sur lui-même, à travers la vision singulièrement concordante d’auteurs venus du monde entier. La rareté des films proprement politiques ou historiques corrobore ce sentiment.
La plupart des œuvres qu’on vient de citer mettent en jeu des histoires intimes, où la mort doit être vue à la fois comme une condition souvent inaugurale de l’action et comme une épreuve individuelle pour les personnages. Ce qui en résulte est un questionnement lancinant sur le travail de deuil et le sens de l’existence, sur le recours métaphysique ou le secours de la croyance.
Quelques films se sont ainsi explicitement confrontés à la question de la foi, livrant sur le sujet des réponses variées, qui vont de la célébration d’un miracle dans une secte protestante mexicaine (Lumière silencieuse) à la déréliction d’une mère trahie dans sa foi en Corée (Secret Sunshine), en passant par une parabole de l’Annonciation en Russie Le Bannissement) ou le tâtonnement messianique de l’action humaine à Jérusalem (Tehilim).
Une forme d’adieu ?
Mais ces approches du fait religieux doivent aussi être considérées comme une interrogation sur le cinéma comme art de la croyance, rejoignant à cet égard les films plus matérialistes de cette compétition. Une interrogation d’autant plus pressante que l’affaiblissement de cet art, qu’il s’agisse d’ailleurs du cinéma populaire ou du film d’auteur, est en jeu. Le paradoxe, on l’a encore constaté cette année à Cannes, est que cette inquiétude profonde suscite, sur le plan esthétique, une réelle diversité de réponses, et pour tout dire une indéniable vitalité. A côté de variations inspirées sur des genres classiques (où les Américains, de James Gray aux frères Coen, ont excellé), les propositions vont de la forme majestueuse, de la puissance tellurique et de l’affirmation orgueilleuse du geste artistique (Lumière silencieuse, Le Bannissement, L’Homme de Londres) à un art ténu, modeste, cultivant la proximité avec les personnages et l’approche documentée (4 mois, 3 semaines et 2 jours, Tehilim, La Forêt de Mogari...). En d’autres mots, d’un monde subjugué à un monde révélé, de la clameur épique au murmure de la vie.
L’un comme l’autre, il dépendra toujours des spectateurs, en dernier ressort, de les entendre ou de les ignorer, et c’est précisément à eux, désormais infiniment plus nombreux devant leur écran d’ordinateur ou de téléphone, que s’est adressé cette année le festival en mettant à l’honneur le thème de la salle de cinéma.
Trente-cinq réalisateurs prestigieux, venus de vingt-cinq pays et de cinq continents (de Manoel de Oliveira à Youssef Chahine, en passant par les frères Dardenne, Michael Cimino ou David Cronenberg) furent ainsi invités par Gilles Jacob à réaliser un petit film de trois minutes sur ce thème imposé, le montage de ces contributions formant un film de durée normale découvert durant le festival. Délicieuses et inventives pour la plupart, ces saynètes ont néanmoins un autre point commun, elles se déroulent majoritairement dans des salles désertées. Le film est donc au diapason de cette soixantième édition, d’une haute et mélancolique tenue, portant jusque dans la mort l’amour invétéré du cinéma, et à travers lui peut-être une certaine idée de la communauté des hommes.
(Jacques Mandelbaum, Le Monde du 29 mai 2007)
 En
En
 Fr
Fr