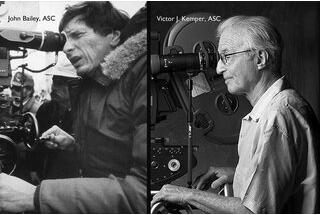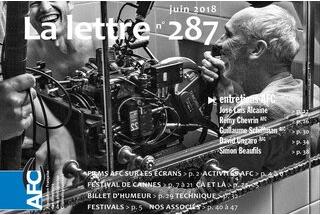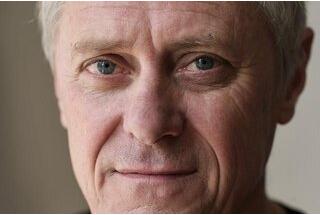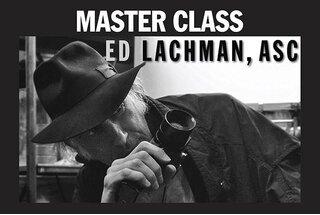"Fellini est plus grand que le cinéma"
Un essai du réalisateur, scénariste et producteur Martin ScorseseHommage d’un maître à un autre, un essai de Martin Scorsese
Caméra à l’épaule, un jeune homme, ou un adolescent attardé, marche vers l’ouest dans une rue bondée de Greenwich Village. Sous un bras il porte des livres, dans l’autre main il tient un exemplaire du Village Voice. Il avance à toute allure, doublant des hommes en manteau et à chapeau, des femmes en fichu qui poussent des Caddie pliables, des couples qui se tiennent par la main, des poètes, des maquereaux, des musiciens et des ivrognes, passant devant des pharmacies, des magasins d’alcools, des restaurants et des immeubles. Le jeune homme ne paraît remarquer qu’une chose : l’enseigne du cinéma Art Theatre, où sont placardés Shadows, de John Cassavetes, et Les Cousins, de Claude Chabrol. Il marque un arrêt, puis traversé la 5e Avenue et poursuit sa route vers l’ouest, filant devant des librairies, des disquaires, des studios d’enregistrement et des magasins de chaussures, jusqu’à déboucher sur le Playhouse de la 8e Rue : au programme, Quand passent les cigognes et Hiroshima mon amour, et prochainement À bout de souffle, de Jean-Luc Godard !
On le suit toujours tandis qu’il tourne à gauche dans la 6e Avenue et traverse la rue pour examiner la devanture du Waverly Marquee, où passe Cendres et diamants, d’Andrzej Wajda. Il fait demi-tour et remonte la 4e Rue, le long de la Judson Memorial Church, jusqu’à Washington Square, où un homme au costume élimé distribue des flyers représentant Anita Ekberg en fourrure : La dolce vita vient de sortir dans une grande salle de Broadway, les billets sont achetables à l’avance.
Il descend la place LaGuardia et s’arrête devant le cinéma de Bleecker Street, qui passe À travers le miroir, Tirez sur le pianiste et L’Amour à 20 ans, sans oublier La notte, qui entame son troisième mois d’exploitation. [...]

Tourbillon de pellicule
J’ai connu Federico de manière suffisamment proche pour pouvoir l’appeler mon ami. Nous fîmes connaissance en 1970, lorsque je me rendis en Italie pour présenter une série de courts métrages que j’avais sélectionnés en vue d’un festival de cinéma. Il se montra chaleureux, cordial. Je lui dis que pour mon premier séjour en Italie j’avais réservé ma dernière journée à la chapelle Sixtine et à lui-même. Cela le fit rire. « T’as vu, Federico, t’es entrain de devenir un monument barbant », commenta son assistant, sur quoi je lui certifiai que barbant serait certainement le dernier qualificatif qu’il mériterait un jour. Je me souviens également lui avoir demandé où l’on pouvait manger de bonnes lasagnes, et il me recommanda un restaurant merveilleux – Fellini connaissait les meilleurs de la planète.
Quelques années plus tard, ayant déménagé à Rome, je le vis assez régulièrement. On se croisait à l’improviste et on en profitait pour aller manger ensemble. C’était un homme de spectacle, et avec lui le spectacle ne s’arrêtait jamais. L’observer en plein tournage était une expérience inoubliable. C’était comme s’il dirigeait une douzaine d’orchestres en même temps. J’ai emmené mes parents sur le plateau de La Cité des femmes, il courait dans tous les sens, cajolant, plaidant, jouant, sculptant et ajustant chaque élément de son film jusque dans le moindre détail, réalisant sa vision dans un tourbillon de pellicule. Quand nous prîmes congé, mon père dit avec regret : « Je pensais qu’on se ferait prendre en photo avec Fellini », à quoi je lui répondis : « Mais ça a été le cas ! ». Tout s’est passé si vite qu’ils n’en ont rien vu.
L’ère du divertissement visuel
Durant les dernières années de sa vie, j’ai tenté de l’aider à distribuer La voce della luna aux États-Unis. Il s’était heurté sur ce projet à toutes sortes de problèmes avec ses producteurs : ils voulaient une grande extravaganza fellinienne, il leur a donné quelque chose de bien plus méditatif et sombre. Aucun distributeur ne voulait y toucher, et je fus singulièrement choqué de voir que personne, pas même parmi les responsables des salles indépendantes majeures de New York, ne s’est même soucié de le projeter. Les vieux films, d’accord, mais pas le plus récent, qui se révélerait être son dernier. Un peu plus tard, j’aidai Fellini à trouver des financements pour un projet de documentaire qu’il avait préparé, une série de portraits de professionnels du cinéma : l’acteur, le chef opérateur, le producteur, le régisseur (je me souviens que dans l’ébauche de cet épisode le narrateur expliquait que la chose la plus importante à assurer, lors de la recherche des lieux de tournage en extérieur, c’était la proximité entre le plateau et un grand restaurant). Hélas, Fellini mourut avant de pouvoir concrétiser son projet. Je me souviens de la dernière fois que je lui parlai au téléphone. Sa voix paraissait si faible et c’était triste de voir cette incroyable force de vie l’abandonner.
Tout a changé – le cinéma autant que l’importance qu’on lui accorde dans notre culture. Certes, on ne saurait être surpris que des artistes comme Godard, Bergman, Kubrick et Fellini, qui jadis régnaient tels des dieux sur notre septième art, finissent avec le temps par s’estomper dans les mémoires. Mais, au point où nous en sommes, il n’est plus rien que nous puissions prendre pour acquis. Nous ne pouvons plus compter sur l’industrie du cinéma telle qu’elle est aujourd’hui pour prendre soin du cinéma. Sur ce marché, devenu celui du divertissement visuel plutôt que du cinéma, le mot qui compte est "marché", et la valeur de toute chose déterminée par le volume d’argent que son propriétaire peut en tirer – en ce sens, n’importe quel chef-d’œuvre est à présent plus ou moins lyophilisé et prêt à s’engouffrer dans le tunnel du "film d’art" sur une plate-forme de streaming. Ceux d’entre nous qui connaissent le cinéma et son histoire doivent partager leur amour pour eux et leurs connaissances avec le plus de monde possible. Nous devons expliquer aux propriétaires actuels de ces films qu’ils valent infiniment mieux que leur stricte valeur d’objet à exploiter et à mettre sous clé après usage. Ils comptent au nombre des plus grands trésors de notre culture et doivent être traités en tant que tels.
Je suppose que nous devons également apprendre à distinguer le cinéma de ce qu’il n’est pas. Fellini peut nous y aider mieux que quiconque. Car on peut dire beaucoup de choses de ses films, mais il en est une que personne ne peut contester : ils sont le cinéma. Et le travail de Fellini n’a pas fini de définir le septième art. »
NB : Ces quelques paragraphes ne sont que le début et la fin de l’essai de Martin Scorsese, qui emplit à lui seul deux pleines pages du "Diplo".
- Lire l’essai en entier dans sa version originale, en anglais, sur le site Internet du Harper’s Magazine ou mieux, se procurer Le Monde diplomatique du mois d’août chez son marchand de journaux le plus proche.
Les intertitres sont de la rédaction du Monde diplomatique.
En vignette de cet article, la couverture, en partie, du Harper’s Magazine.
 En
En
 Fr
Fr