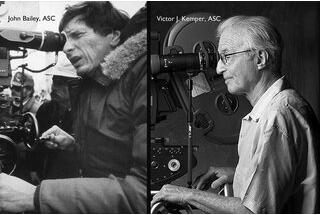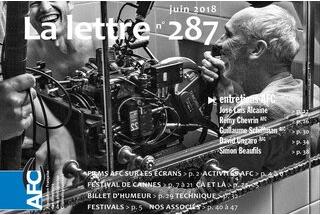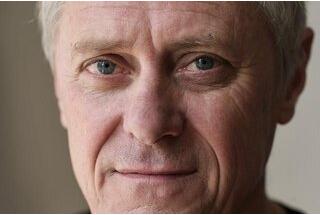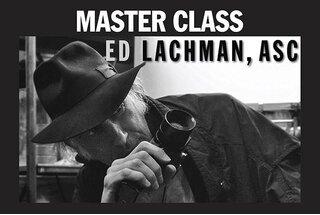Hovig Hagopian fait part de son expérience sur le court métrage documentaire "Storgetnya", qu’il a réalisé et photographié
Comment s’est construit ce projet ?
Hovig Hagopian : C’est mon film de fin d’études de La Fémis. J’avais très envie de faire un exercice documentaire à l’étranger, surtout en Arménie car j’ai des origines arméniennes. Je cherchais des lieux qui avaient été construits à l’époque soviétique, ou qui étaient marqués de cette époque-là, et qui étaient toujours en exploitation. Je voulais aussi un lieu qui soit l’unique décor du film. Un jour, un photographe arménien m’a envoyé une série de photos, qu’il avait faites il y a dix ans, dans cette mine de sel, qui est en même temps une clinique pour asthmatiques. J’ai vérifié, rien n’avait bougé depuis dix ans, le lieu existait encore, c’était exactement la même chose. Comme j’étais déjà rentré de mes premiers repérages, je me suis servi des photos pour monter mon dossier. C’était compliqué d’entrer en contact avec le directeur de la mine et je ne savais pas si il allait accepter, alors, un jour en décembre, j’y suis allé et finalement il a accepté. Je suis resté en repérages à la clinique pendant dix jours et j’y suis retourné pendant une semaine pour le tournage en mars. Initialement je devais y aller pour quinze jours, mais il y a eu le premier confinement en France, et j’ai été rapatrié. Ça s’est donc écourté à six jours de tournage.

J’ai écrit un mémoire sur le travail du chef opérateur en documentaire et les différents dispositifs possibles. J’y pose des questions comme : pourquoi est-ce que certains réalisateurs partent avec un chef opérateur et d’autres non ? Qu’est-ce que ça fait d’être chef opérateur et réalisateur ? Qu’est-ce que les collaborations apportent ? Est-ce que ce sont des films différents ? Si on part faire l’image sur un film de cinéma documentaire, à quoi est-ce qu’on se confronte et qu’est-ce que ça provoque ? Là, par exemple, de faire le point, l’image, la réalisation, tout en même temps, au final, c’était assez agréable car je me sentais complètement libre. En documentaire, quand on fait le cadre, on pose le regard sur des gens, c’est un peu de la mise en scène aussi, et vu qu’il faut aller vite parfois, il y a un travail de collaboration avec le réalisateur qui nous implique d’autant plus que sur une fiction.
Quel matériel et quel dispositif as-tu utilisés ?
HH : J’ai tourné avec une Amira et des GO. J’ai utilisé pratiquement tout le temps le 25 mm ; et le 35 mm sur les plans plus serrés. Les repérages avaient permis de voir ce qui fonctionne ou non avec le décor, en terme de cadres, de focales, de ratio, etc. Au final j’avais l’impression que c’était intéressant de garder en hauteur pour sentir le fait qu’on est vraiment à l’intérieur d’un foyer, sentir qu’on est toujours entouré de quelque chose, comme un cocon, d’où mon choix de focales courtes et de ratio 1.66.
Je m’étais fixé des contraintes : je voulais que le film se fasse entièrement sur pied, que ce ne soit quasiment que des plans fixes et avec une focale unique pour me forcer à me rapprocher des gens si j’avais envie de faire un gros plan. C’était un principe que j’avais envie d’essayer, je trouve que c’est intéressant, surtout en documentaire, pour avoir une cohérence esthétique déjà, mais aussi dans le rapport humain qu’on a avec les personnes qu’on filme. Si on a envie de se rapprocher de quelqu’un, on va se rapprocher physiquement de lui. Ça traduit aussi notre rapport à l’autre.

Les patients de la clinique m’ont accepté assez vite, et étaient vraiment motivés pour faire le film. Parfois ils étaient des collaborateurs de mise en scène, on discutait des plans avant de les faire. C’était un peu comme des moments de fiction où il fallait mettre en scène, et ils se prenaient au jeu. Le matin, ils me demandaient ce qu’on allait faire comme scène aujourd’hui, c’était très joyeux. Il ne se passe pas grand-chose dans la clinique, il marchent, il dorment, ils font deux exercices dans la journée qui durent vingt minutes, donc en fait ils sont très disponibles, c’est propice pour discuter, rencontrer des gens.
Je ne voulais pas qu’on sente nécessairement ma présence dans le film. Il y a juste à la fin ce monsieur qui se livre sur son travail dans un moment un peu plus intime. Je savais que ce personnage-là m’intéressait, et je me suis dit qu’il fallait absolument qu’on arrive à trouver un moment pour parler de sa vie, de son ressenti par rapport à ce lieu, à son travail, à son passé. Ça fait 50 ans qu’il descend sous terre tous les jours, c’est quand même assez particulier. Et il est toujours là, content. C’est vraiment à la dernière heure du dernier jour de tournage, qu’on est allé dans cette grande grotte, et je lui ai demandé ce qu’il en pensait, ce que ça lui évoquait. Je n’avais pas trop fait ça avant parce que je n’avais pas eu le temps, et aussi parce que je n’osais pas.
Et ce plan où la lumière s’éteint...
HH : Ça c’était vraiment un coup de pot. Je ne faisais pas des heures de rushes. On a un exercice à La Fémis que j’aime bien, c’est les "Minutes Lumière" : il faut faire des plans fixes sur pied, dehors. Il faut lancer au bon moment, couper au bon moment et que ça fasse à peu près une minute – basé sur les films Lumière. Donc j’étais parti avec ce principe-là, de n’appuyer sur "Rec" qu’au moment où je sentais qu’il y avait un truc qui se passait, une tension qui était plus calme, et que c’était à ce moment-là qu’il fallait y aller, et que ça ne servait à rien que ça traîne. Et là, ça faisait deux-trois minutes que je filmais, et d’un seul coup la lumière s’est éteinte. La panne a duré cinq minutes, je courrais dans tous les sens pour essayer d’avoir des plans. Le petit garçon a commencé à jouer de la guitare, ils s’éclairaient avec des lampes torches, je leur demandais de s’éclairer entre eux. C’était très drôle, très excitant à vivre un moment comme ça. À ce moment-là, on est heureux d’être là au bon moment, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler à l’image, mais en fait au dérushage, on se rend compte que c’est possible de faire une séquence avec ça. Surtout que la femme qui gère la clinique parle dans les premiers rushes du fait qu’il peut y avoir des pannes, mais ça je ne l’avais pas compris car je ne parle pas un arménien qui est très fluide, et c’est au dérushage qu’on a découvert qu’elle avait parlé de panne, et que ça pouvait se relier.
Comment as-tu éclairé ce décor si singulier ?
HH : Quand j’ai vu les photos, j’ai eu l’impression que c’était un lieu très glauque. C’est assez effrayant de se dire qu’on est 300 mètres sous terre, rien n’est très sécurisé, c’est une installation soviétique qui n’a pas bougé depuis 60 ans, ça fait un peu peur. Pourtant une fois qu’on est là-bas, on ne ressent que le calme. C’est bizarre car on n’a pas l’habitude d’être dans des endroits où il n’y a aucune pollution sonore, et là on n’entend plus rien, c’est le calme absolu, il n’y a pas d’écho. C’est aussi très haut de plafond et lumineux. Tous les murs sont très texturés et il y a des tubes partout. J’avais discuté de comment éclairer ce lieu avec Katell Djian* qui m’avait aidé. Elle m’avait conseillé de me servir de la lumière utilisée sur place, et de mettre des choses qui sont un peu plus propres en termes de colorimétrie à l’intérieur, comme pour les tubes. Mais elle avait raison en me conseillant de ne pas emmener trop de matériel. De toute façon je n’avais pas le temps, les journée étaient de 10 à 14 heures, donc j’étais sur place 4-5 heures maximum. La lumière était assez douce à certains endroits, donc il fallait plus couper que rajouter des choses. J’enlevais des tubes quand ça ne m’intéressait pas, je dirigeais des tubes, mais je n’ai pas passé beaucoup de temps là-dessus.

L’étalonneur ,c’est Caïque De Suza. C’est quelqu’un de très gentil, trop fort, avec un super regard. J’avais pré-étalonné mes rushes assez simplement mais il y avait une teinte sépia à laquelle je m’étais habitué. Tout d’un coup, il a re-donné une couleur au film, une brillance, et ça fonctionne très bien. Sur le moment, j’avais un peu peur mais finalement je me dis qu’il a vraiment eu des super idées. Il est allé chercher plus loin qu’un étalonnage basique dans les correspondances de couleurs et dans les contrastes sur le visage, des points de contraste sur lesquels il a passé beaucoup de temps. C’est un gros collaborateur de l’image sur ce film.
Comment s’est faite la sélection à Camerimage ?
HH : Il y a deux ans, quand je suis allé à Camérimage en tant qu’étudiant avec La Fémis, j’étais allé voir les court métrages documentaires. Il y avait plein de films différents, dont un de l’INSAS qui s’appelle Le Veilleur, j’avais écrit un article pour l’AFC à son sujet. Après avoir vu ce film-là, je m’étais dit que j’avais envie de faire un court métrage documentaire comme film de fin d’études, d’être à la fois réalisateur et chef opérateur, et je rêvais de présenter mon film à Camerimage. Donc être sélectionné, c’était une super surprise. C’est un des festivals que j’ai faits qui m’a le plus plu, je trouve que c’est un endroit où l’on peut faire de très belles rencontres.
Et après ?
HH : Pour l’instant la priorité, c’est de faire le plus possible de films en chef opérateur, avant de réaliser à nouveau. J’ai eu plein de projets différents, de fiction, de pub, de clip, plein de choses très variées qui étaient assez excitantes, où j’avais envie d’essayer plein de choses. Pendant un an, j’ai rencontré de nombreuses personnes, des réalisateurs avec qui j’ai beaucoup aimé travailler.
Avec la productrice du documentaire, on a très envie de repartir faire un film car on a eu un bon accueil en festival donc c’est très encourageant, on se dit que ça plaît, et que ce qu’on propose peut intéresser les gens. Il y a des sujets qui m’intéressent, des lieux où j’ai envie d’aller, des histoires un peu différentes qui sont toujours en lien avec l’Arménie, et qui se passent autour de la langue, de la culture dans les communautés, mais c’est encore vague.

* Katell Djian est directrice de la photographie et intervenante à La Fémis.
(Propos recueillis par Margot Cavret pour l’AFC)
- Lire ou relire l’article rédigé par Hovig Hagopian sur la sélection de courts métrages documentaires à Camerimage en 2019.
 En
En
 Fr
Fr