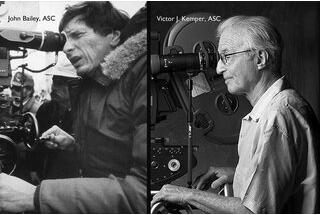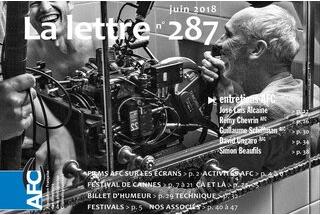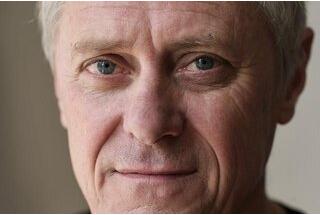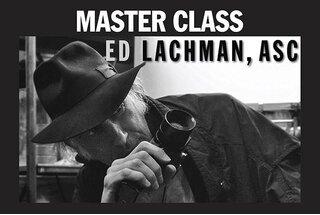"Le 7e art va-t-il perdre la mémoire ?"
Par Samuel BlumenfeldPrenez votre film favori : Citizen Kane, d’Orson Welles, L’Aurore, de Murnau, Les Enfants du paradis, de Marcel Carné, ou une production plus récente comme La Guerre des étoiles, de George Lucas. Imaginez maintenant que ce film disparaisse, à la manière d’un des livres autrefois déposés à la bibliothèque d’Alexandrie. Ou qu’on ne puisse plus le voir autrement que sur rendez-vous, comme un manuscrit du Moyen Age.
Ce scénario cauchemardesque n’est pas encore d’actualité, mais il pourrait le devenir. Car à l’heure du tout-numérique, les incertitudes liées à la conservation et à la circulation des films sont nombreuses. Par un étrange paradoxe, c’est au moment où nous pensons laisser le plus de traces, grâce à des technologies sophistiquées, que nous pourrions en laisser le moins.
Le numérique est un colosse aux pieds d’argile. Ses faiblesses sont identifiées. Dès 2007, dans un rapport intitulé " The Digital Dilemma " (" Le dilemme numérique "), l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences américaine relevait plusieurs facteurs qui, conjugués, dressent un tableau très sombre des dangers liés à cette technologie : pertes d’archives liées à l’erreur humaine ; effacement des données au bout de plusieurs années ; pannes de disque dur magnétique ; nécessité pour la conservation des bandes LTO (linear tape-open) d’organiser des migrations en prenant en compte l’apparition de nouveaux formats décidés par le fabricant et l’obsolescence des lecteurs-enregistreurs pour lire ces bandes, qui intervient environ tous les cinq ans ; enfin, coût prohibitif de l’archivage – entre quatre et vingt fois plus élevé que son équivalent 35 mm.
« Illusion numérique »
« Nous vivons dans l’illusion numérique où nous croyons qu’à partir du moment où les films sont disponibles, ils le resteront toujours », observe Jan-Christopher Horak, du département des archives filmées de l’Université de Californie à Los Angeles, le plus important centre d’archivage de films aux Etats-Unis après la Bibliothèque du Congrès. « Or, non, c’est un mirage. Je me demande s’il ne faut pas déjà nous faire à l’idée qu’une partie de la mémoire visuelle du XXIe siècle disparaisse purement et simplement. »
En matière de matériel cinématographique, nous sommes en effet à un carrefour. Depuis le début de l’histoire du cinéma et jusqu’à la fin des années 1990, la plupart des films étaient tournés sur un support photochimique et un format universel, celui de la pellicule 35 mm. A condition d’être durablement conservé, en respectant des conditions de température, de lumière et d’humidité satisfaisantes, le 35 mm possède une durée de conservation supérieure à cent ans. Mais les fameuses bobines, si chères au cœur des cinéphiles, sont maintenant de l’histoire ancienne.
En janvier, le studio américain Paramount annonçait l’abandon définitif du 35 mm, tandis que Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, devenait le premier film tout numérique de l’histoire de la compagnie, ce qui n’est pas sans ironie quand on connaît le combat du réalisateur de Taxi Driver pour la préservation du patrimoine cinématographique. Cette décision entérinait un état de fait : l’écrasante majorité des films produits dans le monde sont aujourd’hui tournés en numérique. Le " numérique natif " devient la seule norme.
Images calculées par ordinateur
Il est facile de comprendre pourquoi cette technologie a conquis progressivement tous les maillons de la chaîne de l’image et du son. Au stade de la production, d’abord, les caméras électroniques ont remplacé la pellicule 35 mm, très onéreuse. En postproduction ensuite, les effets visuels et l’animation relèvent d’images calculées par ordinateur. Enfin, dans le domaine de la distribution, 93 % des salles de cinéma en France étaient équipées, fin 2013, de projecteurs numériques – un taux comparable à celui d’autres pays, en Europe de l’Ouest, en Asie, et aux Etats-Unis.
Le bénéfice pour les producteurs de cinéma est massif : grâce au numérique, ils réalisent une économie considérable sur les tirages de copies (90 euros pour une copie numérique contre 1 500 euros pour son équivalent en 35 mm) et sur leur acheminement vers les salles. Aujourd’hui, un exploitant récupère un DCP (digital cinema package) : un ensemble de fichiers informatiques qui est l’équivalent numérique de la copie de projection, se présentant sous une forme rectangulaire d’une vingtaine de centimètres de largeur. Dans un proche avenir, ce DCP pourrait tout à fait disparaître et se trouver remplacé par un signal satellitaire, envoyé directement d’un laboratoire à la salle de cinéma.
La chaîne du numérique s’étend aussi à l’archivage des données, donc à la conservation des films. Ceux qui se trouvent sur support argentique ou qui ont été tournés d’emblée en numérique (le " numérique natif ") sont transférés sur des disques durs magnétiques ou des serveurs distants interconnectés, selon le principe du" cloud computing " (information en nuage), ou encore stockées sur une cassette magnétique LTO, le format de stockage dominant pour l’industrie cinématographique.
Risques énormes
Or cette migration de l’analogique vers le numérique se double de risques énormes. Et pas seulement pour le patrimoine cinématographique, puisque le papier est lui aussi concerné. Le problème, c’est que personne ne sait vraiment combien de temps peuvent se conserver les fichiers numériques – en tout état de cause, bien moins d’un siècle. Procédant à une enquête auprès des studios de cinéma, mais aussi auprès d’autres grands opérateurs américains (industrie pétrolière, Bibliothèque du Congrès, défense, santé, sciences de la Terre) pour lesquels la conservation sûre et pérenne de leurs archives est un enjeu crucial, " The Digital Dilemma " dressait une conclusion sans appel : il n’existe pas, à ce jour, d’alternative à l’archivage sur film analogique po ur conserver sur une période de cinquante ans ou plus.
Un constat que Christophe Gauthier, directeur du département de l’audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France, commente en affirmant que « la problématique majeure est celle de fichiers numériques natifs », autrement dit ceux pour lesquels il n’existe aucune copie en 35 mm. Soit l’intégralité de la production audiovisuelle d’aujourd’hui !
Dans un rapport sur la conservation des films rendu public, en juin 2011, par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), René Broca et Etienne Traisnel stigmatisaient, eux aussi, l’absence à ce jour de support numérique garantissant un archivage de longue durée. En outre, ils relevaient le fait que l’obsolescence des supports nécessite des migrations régulières, en théorie sans fin, qui ont un coût.
Copie 35 mm intacte
C’est exactement ce que montrent les mésaventures de Jan-Christopher Horak, lors de la restauration, en 2009, des Chaussons rouges, du réalisateur anglais Michael Powell. « J’ai effectué une restauration du film, transférée à la fois sur support 35 mm et sur une bande LTO », raconte M. Horak. « Lorsque le standard est passé de LTO3 à LTO4, j’ai dépensé 20 000 dollars [15 000 euros] de transfert. J’ai débloqué la même somme quand nous sommes passés de LTO4 à LTO5. En attendant, ma copie 35 mm est intacte. Si l’on passe à une nouvelle norme de LTO6, je n’effectuerai pas de transfert numérique. C’est trop onéreux. Je reste avec ma bonne vieille copie argentique. L’expérience du numérique est à la fois celle de l’obsolescence programmée et celle de l’effacement accidentel de nos données. C’est un risque que je ne peux me permettre. »
Mais ce n’est pas tout. Car, en matière numérique, l’erreur humaine est une menace bien plus grave qu’avec les copies argentiques. Jan-Christopher Horak cite ainsi deux exemples récents qui ont failli tourner au drame. A la fin des années 1990, en pleine production de Toy Story 2, Pixar avait, à la suite d’une manipulation informatique malheureuse, perdu toutes les données du film, littéralement effacées des disques durs de la compagnie. Un clic à 100 millions de dollars…
Par bonheur, un des employés possédait une copie de sauvegarde sur son ordinateur personnel. Lequel fut rapatrié chez Pixar à bord d’une voiture spéciale, dans une boîte en carton bordée de coton. Tout récemment, en janvier, la BBC reconnaissait que le système de conservation numérique de ses archives d’actualité, dans lequel elle venait d’investir plus de 130 millions d’euros, avait rendu l’âme. Il s’agissait, là encore, d’une erreur humaine. Auparavant, la mauvaise manipulation risquait seulement de corrompre une bobine. Désormais, elle peut mettre en péril toute une collection.
Condamné à disparaître
« Maintenant que nous sommes entrés dans l’ère de la projection numérique, avec des salles qui ne sont plus, pour la plupart, équipées de projecteurs 35 mm, je crains que les producteurs ne comprennent plus la nécessité de posséder une copie argentique de leur film », redoute Milt Shefter, l’un des auteurs de " The Digital Dilemma ". « Or un film dans une seule copie numérique est condamné à disparaître à moyen terme. Cela me terrifie. Je crains que nous ne retournions à l’époque du cinéma muet, où les films étaient montrés une semaine ou deux, puis disparaissaient. »
Et parfois pour de bon : on estime que moins de 20 % des films tournés avant 1920 et moins de 50 % des films tournés avant 1950 ont survécu. Des chiffres qui s’expliquent d’abord par la nature du support utilisé jusqu’à cette date : le nitrate, qui s’enflamme à une température relativement faible et peut même brûler spontanément — depuis les années 1980 le support polyester est utilisé.
Les destructions tenaient aussi à l’ignorance ou au déni de la valeur patrimoniale de la production cinématographique à l’époque du muet. « Cette histoire peut se poursuivre », craint Joël Daire, directeur délégué du patrimoine à la Cinémathèque française. « On est toujours, lors de chaque mutation technologique, dans une logique de déstockage massif. »
Les studios américains ont fait le choix de conserver dans des sites sécurisés les négatifs 35 mm de chaque film de leur catalogue. « Le 35 mm reste à ce jour notre seule option pour préserver notre catalogue », confirme Ned Price, responsable du fonds Warner, le studio détenteur du plus important catalogue de droits audiovisuels du monde, avec 7 000 longs métrages, 70 000 épisodes de télévision, 15 000 courts métrages d’animation. Même politique chez Gaumont qui, fort de 1 000 longs métrages, détient l’un des plus importants catalogues de France, avec Pathé, Studio Canal, SND et TF1.
Un retour sur pellicule coûte cher
« Nos copies 35 mm sont entreposées dans deux endroits différents », confirme Ariane Toscan du Plantier, directrice de la communication et du patrimoine chez Gaumont. « Pour chaque nouvelle production, nous faisons tirer une copie 35 mm. » Une action menée par les grandes maisons de production, américaines et européennes, qui ont saisi l’enjeu, patrimonial et économique, d’un transfert sur 35 mm. Mais qu’en sera-t-il des producteurs plus modestes qui n’ont pas conscience du danger et ne possèdent pas les ressources financières pour sauvegarder leur catalogue ?
Un retour du numérique sur pellicule coûte cher, environ 30 000 euros. « Les producteurs ne mettent pas ce transfert sur leur devis initial », explique Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC. « C’est dommage, car c’est un poste auquel il faut penser dès le départ. On espère arriver à trouver un système de soutien au retour sur pellicule. Et je ne sais pas si le CNC aura les moyens d’en financer au moins une partie. On est conscients du trou noir qu’on est en train de fabriquer. Il y a toute une génération qui risque de ne plus avoir d’images d’elle. »
Sans compter que, là aussi, le paysage pourrait bien changer, à moyen ou à long terme, si Kodak ou Agfa cessaient de fabriquer de la pellicule. Fuji a déjà arrêté, en mars 2013, la fabrication et la vente de ses pellicules positives et négatives pour le cinéma. Au-delà, le réseau des laboratoires, dont le chiffre d’affaires provient en partie du tirage des copies 35 mm, se trouve dans une situation critique. Il ne reste plus en France qu’Eclair et Digimage. LTC a fermé, GTC a été racheté par Eclair et réduit à néant. Natacha Laurent, déléguée générale de la Cinémathèque de Toulouse, se demande si les cinémathèques ne devront pas se mettre en coopérative afin de conserver une filière argentique.
A cela s’ajoute que la projection des films en 35 mm risque de devenir de plus en plus compliquée. D’abord, le métier de projectionniste est en train de disparaître. Or la profession requiert un savoir-faire spécifique, afin de ne pas endommager les copies. Ensuite, les projecteurs eux-mêmes sont en passe de devenir des objets si rares que les cinémathèques, qui pourraient être condamnées à devenir des conservatoires de la pellicule, ne sont plus assurées de le trouver encore longtemps.
Copies endommagées
« Combien de temps pourra-t-on par exemple trouver des pièces de rechange pour les vieux projecteurs 35 mm ? », se demande Joël Daire, à la Cinémathèque française. « Ma préoccupation est de pouvoir montrer le cinéma sur pellicule. La cinémathèque diffuse hors de ses murs 1 000 copies de ses collections par an dans le monde, et il faut voir dans quel état les copies nous reviennent. » A la Cinémathèque de Toulouse, Natacha Laurent déplore aussi de voir revenir des copies endommagées par des projectionnistes étrangers au 35 mm. Reste que le combat pourrait s’éteindre faute de combattants.« Si vous voulez faire sortir vos copies dans un festival, ils ne veulent plus de 35 mm, car ils n’ont que des projecteurs numériques », souligne Natacha Laurent. « C’est une vraie remise en cause de la circulation du patrimoine. »
Un autre problème est celui du projecteur numérique, dont la mise à jour est perpétuelle. Bien souvent, un projecteur nouvelle génération ne peut décoder un DCP pourtant âgé de seulement 3 ans. « Cela nous est arrivé avec un DCP fabriqué par Studio Canal de La Grande illusion, de Jean Renoir », se souvient Béatrice de Pastre. « Le film était projeté en 2013 au festival de Gindou, dans le Lot. Le DCP était trop " vieux " pour être lu par un projecteur nouvelle génération, il n’y avait plus de programme permettant le décodage des fichiers de ce DCP. » La question du DCP, qui a désormais remplacé la copie 35 mm, n’est pas anodine. Ses données peuvent s’effacer au bout d’un an. Crypté, il n’est lisible qu’avec une clé, fournie à l’exploitant par le distributeur, que ce dernier donne avec réticence aux cinémathèques par crainte du piratage. Enfin, cette copie numérique n’est ni pérenne ni nécessairement de bonne qualité.
Il y a encore quelques mois, Ned Price, qui gère le catalogue Warner, reconnaissait traverser une intense période de dépression, se demandant s’il était possible de préserver son fonds. « Puis, je me suis dit qu’il n’y avait pas d’autre choix. Le média numérique est encore balbutiant. Il faut être optimiste et relever ce défi. » Celui-ci consiste à trouver une norme pérenne de conservation numérique permettant de conserver les fichiers au moins cent ans.
Serge Bromberg, patron de Lobster Films, à qui l’on doit les restaurations des principaux moyens métrages de Charlie Chaplin et du Voyage dans la Lune, de Georges Méliès, est persuadé qu’un système de préservation éternel du numérique verra le jour. « L’écriture se faisait sur papier vélin, elle se fait aujourd’hui sur papier recyclé. Le numérique est aujourd’hui la norme, et l’on trouvera un système pérenne de sauvegarde des données. A mon sens, une autre question importe : de quoi doit-on se souvenir ? Il se produit aujourd’hui chaque année autant de données audiovisuelles que dans les cinquante années qui ont précédé. A l’échelle d’une société comme Lobster, comme pour les cinémathèques, se pose le problème des milliers de copies déposées qui ne pourront jamais être restaurées. » Après les affres de la conservation, il faudra sans doute affronter celles du tri…
(Samuel Blumenfeld, Le Monde, 24 avril 2014)
 En
En
 Fr
Fr