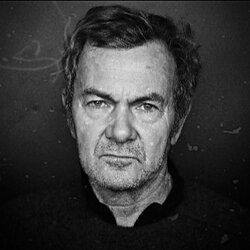"L’Animalité" - A propos de "Flandres", un film de Bruno Dumont
par Jean-René DuveauC’est pendant le festival de Cannes. A la radio, un critique du Figaro, discute avec Antoine de Baecque, à propos du dernier film de Bruno Dumont. La discussion tourne court. Pour ce critique, Flandres, ce n’est sûrement pas du cinéma. De Baecque, lui, défendait le travail cinématographique de Bruno Dumont.
Depuis j’ai vu le film, et je sens bien maintenant, à travers les propos échangés, tout ce que moi-même, après la projection, ne pouvait m’empêcher de penser, avec quelque incertitude, et comme ce critique, peut-être, ressentir à quel point les films de cet auteur en viendraient à s’ériger en un système clos, refermé sur lui-même. C’est dire que, le propos du film et sa forme, peuvent facilement amener une position morale sur : ce que c’est qu’un homme et sur ce que ça doit être, sur ce que c’est le cinéma ou comment il faudrait qu’il soit pour mériter ce nom. Pourtant ce nom, cinéma, ne renvoie à rien d’autre que : mouvement, déplacement, écriture, transport. Ce qu’est le cinéma, ce qu’est la littérature, la peinture, ce qu’est le saucisson d’Auvergne, ce qu’est la couleur verte... A quoi bon. Nous n’en sortirions jamais. Réflexions...
Quelques mois plus tard, dans un article des récents Cahiers du Cinéma, une réponse de Bruno Dumont à un journaliste, à propos de la conception des scènes de guerre :
« La télévision constitue le réel, le cinéma peut s’abstenir de le répéter »...
Cette phrase-là s’est mise à tourner en boucle... J’ai toujours pensé que la télévision avait depuis longtemps choisi le camp de l’imaginaire : car ce n’est pas à filmer une réalité devant une caméra, que pour autant, du réel s’enregistre. C’est peut-être oublier là, deux choses : la caméra et son œil borgne d’un côté de l’image, et le spectateur dans son aveuglement face au réel, de l’autre côté de cette même image. Là où l’imaginaire peut s’entamer puis se rompre, le réel lui n’a ni début ni fin : complexe, a-dimensionnel, infini, c’est dire un réel à jamais impossible à saisir, et « qui ne cesse pas de ne pas s’écrire ».
Pourtant le cinéma reste doué d’une possibilité d’écriture dont le monde télévisuel lui, a fait le choix de ne plus s’encombrer : A l’heure où ses flux sont tels qu’ils imposent de ne plus avoir à se poser de questions existentielles, la production qui en ressort, ce n’est pas une nouveauté de le dire, est le jus pressé, compressé d’un formatage, c’est-à-dire une mise en forme, mise en un moule, où la matrice est déjà une image en soi, image en creux, dans laquelle se coule et se pétrifie la pâte à prendre du réel. Ce que constitue la télévision donc n’est que la reprise incessante de notre imaginaire, car c’est là que les gains sont le plus à en attendre. Qui pourrait attester que les reportages les plus crus de nos actualités quotidiennes puissent ainsi créer un sentiment d’étrangeté : c’est pourtant là que le réel se révèle au grand jour. A l’opposé, c’est à l’appel du sentiment, du ressentiment, du déjà vu, connu, entendu que la caméra et les machines de montage semblent lancer des têtes chercheuses, à l’adresse d’un imaginaire de plus en plus collectif. Ce n’est pas nouveau : catastrophes, bonheurs familiaux, la dure réalité du monde, la jouissance immédiate, la vie des animaux, la complétude du gain, et le sentiment d’appartenance à une communauté, soit, se reconnaître à tout prix dans une image satisfaisante. Non, la télévision n’est pas une fenêtre sur le monde, mais un miroir, de moins en moins déformant.
Ça tournait donc en boucle parce que Flandres justement, se situe à une place singulière, décentrée de l’écriture usuelle, pour convoquer à nouveau le réel, dans son sentiment d’étrangeté. Sans en rejoindre le style ni la portée littéraire, Dumont à bien des égards évoque une approche " durassienne " de la réalité. En contrepoint de cette assertion, je repense à ce reportage sur l’attentat du 11 Septembre. Deux frères y filment tout, en temps réel, en poussière réelle, en secousses réelles... Ces deux-là se perdent puis se retrouvent dans une réalité qui se disperse à nouveau dans la poussière des images.
Le cinéma de Bruno Dumont a cette faveur, d’en arriver à une maîtrise assez rare, sinon absente des écrans, de nous restituer cette apparence du réel, dans ses effets, dans ce choc frontal qui fait que le regard sans cesse se détourne, souhaite quitter l’écran, gêne, embarrasse. Comment s’accoutumer du réel, dans sa complexité, dans son extravagance, dans sa dureté ? Si dans le discours actuel, l’on admet assez rapidement que « les temps sont durs », (mais pourquoi seraient-ils plus durs qu’avant ?), c’est peut-être justement que l’imaginaire, au galop, a pris toute la place laissée vacante, diffusée à l’œil du spectateur, au porte monnaie du consommateur, sans qu’aucun sens, ne puisse véritablement s’en dégager. Ce qui est sans aucun doute beaucoup plus dur qu’avant, c’est bien cette impossibilité d’y trouver du sens. Flandres restera pour longtemps aux antipodes de " nos " préoccupations d’aujourd’hui.
Depuis cette projection saisissante, ces retours de critiques, j’ai inscrit ce film à mon histoire personnelle du cinéma. Plus précisément, lui et un autre, L’Humanité du même Bruno Dumont, car les deux films se renvoient l’un à l’autre, et je vais tenter de préciser maintenant, si c’est dans un mouvement de complétude, d’opposition, d’inversion, ou de dispersion.
Flandres, évoque une part d’" animalité ", sans que cela ne puisse s’opposer au titre de son film précédent. Ce n’est pas un contraire, un négatif, c’est manifestement au départ, la même chose, l’humanité, l’animalité. Il y a dans ce film un avant et un après, dont l’entre deux, ce moment de guerre (homme, animal ?) n’est qu’un passage, et pas n’importe lequel.
Anne regardait le film à côté de moi. Elle en était sortie déprimée, abasourdie. Le film est dur, violent, et sans spectacle.
Flandres, c’est avant L’Humanité, c’est avant que ça puisse commencer à parler. C’est de la pré-histoire. C’était déjà dans l’histoire du cinéma, ça, qu’au départ, on ne puisse pas parler. Pour répondre à ce critique du Figaro, il faudrait pourvoir lui rappeler que l’image fondamentale de cet art de l’écriture en mouvement, cette image primitive fut longtemps admise comme étant celle d’un train arrivant en gare de La Ciotat. Ce n’est pas rien, ce qui s’était passé ce soir-là. Il y a eu un mouvement de panique dans la salle du Grand Café, et ce n’était pas un film d’horreur. Ce fut une frayeur : les gens, en courant, ont quitté la salle. Le cinéma commence comme cela et fonde la position du spectateur dans un socle : ainsi nous ne quitterions jamais cette place, cette position d’avoir à être ef-frayés, se frayer un passage, ou quelque chose comme ça, qui vous donne ce sentiment que ça va vous rentrer dedans : ce choc du réel.
Cependant il y a là une erreur fondamentale. Cette histoire de train est un mythe. Il n’a jamais été projeté à la première séance du Grand café, et les spectateurs n’en sont jamais sortis en courant. Ce n’est pas si vieux et pourtant, on avait déjà inventé ça : Mais il nous fallait un mythe, et donner un sens à ce qui pour la première fois, s’offrait au regard comme une effraction, une intrusion, un sentiment d’étrange.
C’est ce que produit Flandres. Un fermier " sa " femme, pour partir vers une guerre improbable.
On peut l’observer, ce fermier dans un plan qui nous en apprend davantage, que dix pages de scénario. Il sort de chez lui, il y a là quelques animaux. On a plutôt l’impression d’ailleurs que ce sont eux, les animaux, qui s’occupent de la ferme. Il croise un autre garçon derrière un baraquement. C’est intéressant cette idée de la guerre, car ce n’est pas qu’un artifice : la guerre, on ne la fait qu’à ceux qu’on ne connaît pas. Pourquoi irait-il la faire alors, à cet autre garçon qui baise sans plus d’allégresse, la même jeune fille ? Ça n’est pas un type moderne ce fermier, un urbain, il ne s’adonne pas à des pratiques échangistes, il ne se jouit pas spécialement d’une maîtrise. Non. Ils sont pareils tous les deux, ils sont semblables, ils ne peuvent se faire la guerre, ou pas comme ça. D’ailleurs il lui sourit, et la guerre, ils vont la faire ensemble, contre d’autres, des étrangers soi-disant, des vrais, car c’est le fantasme qu’ils en ont. C’est mieux. Voilà. D’ailleurs, dans ces mêmes Cahiers du cinéma , le journaliste imagine lui-même (comme quoi, ce besoin d’imaginer, d’en dire toujours un peu plus sur l’histoire racontée, d’en supposer quelque chose), il imagine que le fermier est jaloux, il imagine que le fermier est amoureux... Sur quels indices ? Il évoque le regard... Il donne fantasme au regard, et non pas sens...
Le plan ne s’arrête pas là. Le fermier prend une pelle quand l’autre est parti, et il remue quelques tuiles posées en vrac dans la cour ; il les remue comme on soulève de la dentelle. Il y met tellement d’application ! Il y met tellement plus de précaution que s’il s’agissait de " soulever " une fille !... Puis il s’arrête, il verra ça demain, après la guerre. Voilà un plan. Un réalisateur, un directeur photo, et d’autres bien sûr... Tous derrière et lui devant. On sent bien dans ce plan toute la rigueur susceptible de nous faire saisir, entre les images, une vision.
Tout le film fonctionne ainsi sur les trois registres qui, dans leur intrication, font l’homme, et non l’animal. Plutôt, quand il est animal, avant de devenir homme : le réel, l’imaginaire, le symbolique. Ce n’est pas l’entre-deux de la guerre qui fait l’homme, c’est l’expérience d’une perte, et de la culpabilité qui prend la place. Elle apparaît au travers de cette femme qui a été violée. Elle punit ses agresseurs, en condamnant leur compagnon innocent. Dans Flandres, la cohérence est interne. Elle ne souffre d’aucune comparaison à une autre forme, à un autre film. L’histoire est, partout, dans l’enchaînement des plans, des séquences, dans la photo, dans le son. Qu’on y prenne n’importe quoi, et on y trouve quelque chose. On pourrait parler ainsi du père de la fille, et ne parler que de lui. On pourrait parler d’elle, de sa folie qui, un jour, lui revient du dehors, alors qu’elle était déjà là, dans sa profonde solitude, dans son manque d’amour. Ça lui revient du dehors, cette mère déjà folle, du dehors c’est : cet enfant qui grouille dans son ventre... Sa copine pense : on va dire d’elle que c’est une pute, à se taper comme ça, tous les mecs du village. Mais elle manque d’amour... Est-ce que ça en fait pour autant une pute ? Car ici, rien ne s’échange. Rien ne s’achète, car rien dans l’apparence des êtres, des animaux, de l’architecture, du paysage ne semble avoir plus de valeur qu’autre chose. C’est ainsi que le traitement photographique d’Yves Cape restitue admirablement ce sentiment étrange, d’un glissement toujours possible d’un plan vers un autre plan, sans que ni l’un ni l’autre ne puissent véritablement en prendre " le dessus ". Il n’y a pas de générosité, il n’y a pas d’amour du prochain. Car partout ça manque d’amour, alors ça cherche, à droite, à gauche, dans tous les bords du cadre que Bruno Dumont fige à chaque fois, pour mieux s’y arrêter. Ça rentre dans les maisons, mais ça n’y fait rien. Ça cherche. Le médecin lui-même n’y comprend rien. Si ce n’est : oui, « c’est comme sa mère, votre fille devient folle elle aussi ».
Mais elle manque d’amour. Les Anglais disent « I miss you ». Ils inversent par rapport à nous, le sujet et l’objet sans que l’on puisse savoir réellement, à chaque fois, comme dans chaque histoire d’amour, qui est le sujet, et qui est l’objet. Elle manque. Point. Et Bruno Dumont, lui, ne rate rien, ne perd rien de cette fille qui n’arrive pas à perdre son sang. Elle est enceinte ? D’ailleurs, la sexualité, dans ce film, qu’est ce que c’est ? L’homme bute la femme, dans le trou de la terre. A quelle place met-il cette femme ? A quelle place se met-il lui-même, sinon d’un rapport impossible ? Voilà, une confusion réelle, pas seulement des sentiments, mais de ce que c’est, qu’être un homme ou être une femme. C’est pas si facile que ça, visiblement, dans les films de Bruno Dumont. (Moins facile que ce que nous enseignent aujourd’hui, à coups de forfaits, les opérateurs téléphoniques, les chaînes de télévision, les " créatifs " des boîtes de pub).
Et tout l’art de son film est bien de nous poser, toujours entre les images, et avec une continuité dialoguée qui ne tient qu’en peu de pages, cette seule question. Qu’est ce que c’est ? Entre l’animalité, et l’humanité.
Dans les films de Bruno Dumont, la photographie produit de l’effet au lieu d’en être. Je reviens à cette histoire de train. Pour provoquer cette " frayeur mythique ", il a quand même fallu mettre la caméra à la bonne place, de face, là où le mouvement s’annule, au profit d’une valeur de plan, de plus en plus forte dans l’image. Le train grossit.
Dumont nous impose un rapport frontal à l’image. Dans un face à face parfois difficilement soutenable, il semble que le réalisateur cherche à prolonger l’expérience du tournage, (les acteurs ne maîtrisent rien de ce qui leur arrive) jusque dans la salle de cinéma : le spectateur lui, est toujours dans une position vacillante : y être, ne pas y être - y croire, ne pas y croire - aimer, ne pas aimer...
C’est un outil formidable pour ça, le cinéma. Bruno Dumont se saisit de l’outil, pas d’une histoire, pour faire un film. Il a vu, il a entendu quelque chose. Il ne le raconte pas, il le filme. Bruno Dumont n’est pas un raconteur d’histoires. Qu‘est ce que ça raconterait Flandres ? Deux " petits hommes schrébériens " sont partis à la guerre. Une femme qu’ils se partagent, entre temps, est tombée enceinte. Et l’un n’a rien fait pour que l’autre, le père, en sorte vivant. Mais finalement elle ne lui en veut pas, et ils s’aiment. C’est ridicule. Ce n’est pas ça. Le cinéma de Bruno Dumont tourne sur lui-même, se tient lui-même, sans rien d’autre qui puisse le soutenir. Ce n’est pas la question d’un style ou d’un genre. C’est une question : est-ce que ça va nous tomber dessus, nous écraser ? C’est sans aucun doute, dans l’appartenance à une lignée, bressonienne peut-être. C’est donc la question de ce qui le préoccupe avant tout, et qui est susceptible de nous intéresser nous aussi. Il n’y a pas là, si c’est affaire de morale, de visée commerciale. C’est susceptible de nous intéresser, mais ce n’est pas sûr. D’ailleurs, les avis sont partagés. Là où les films de Ken Loach ou de Michael Moore ne peuvent que produire de l’unanimité, Flandres trace une ligne de partage qui semble se situer à un point controversé des visées du cinéma contemporain : Là où l’on nous montre enfin que l’humanitaire, ça n’est pas du tout l’humanité. C’est un contenant, dans lequel on voudrait y faire entrer toute l’humanité. Au même titre que le documentaire est le contenant de tout ce que l’on pourrait y mettre, de documenté.
Chez Ken Loach, on peut plus facilement parler de style ou de genre... C’est différent, là, car la cohérence est externe : la forme du film est une figure fermée, close sur elle-même, elle est soutenue d’un discours très cohérent mais d’une cohérence qui laisse finalement peu de place à une subjectivité : c’est comme ça. L’homme doit être ça, le cinéma, c’est ça... Avec Bruno Dumont, la rigueur du filmage est poussée au plus loin, mais le discours qui s’en dégage est beaucoup moins tranché, autre indice qui indique au fil des séquences, le saisissement qui nous lie à l’émergence du réel.
Je reviens à la photo. Cette question de la cohérence interne, ce sur quoi, je m’intéresse au travail des directeurs photo, leur apport, leur patience, leur effacement quand d’un coup, on leur demande de se taire. Taire la photographie, taire la photo belle, ou laide, car on peut aussi rencontrer une photo dégradée, forcée, qui nuit tout autant à l’intérêt du film. Question récurrente, souvent débattue dans les cercles professionnels, et dans celui du public. La chose, sans aucun doute, n’est pas toujours facile à décider. Cela indique cette fragilité dans la recherche d’un équilibre et d’une justesse photographique. Là encore, Bruno Dumont/Yves Cape, ne nous laissent pas le choix. Il y a d’autres photos, d’autres genres et d’autres styles, qui sont tels, et ce sont les plus récurrents, que la photo s’harmonise et se fond dans tous les académismes. Savoir photographier, après tout, c’est bien ce que l’on demande aux directeurs photo. Et la plupart le font avec beaucoup de talent. La chose est plus rare quand un film emporte avec lui sa photographie et ne la laisse à personne d’autre, même pas peut-être à son directeur de la photographie. La photo de Flandres est signée, par Yves Cape bien sûr, mais j’entends par là qu’elle est marquée d’un autre : le film lui-même, son transport, allez, j’ose, dans un rapport hypnotique peut-être. La photo d’Yves Cape s’adresse à une entité propre : la cohérence interne du film en est le garant, et la visée. Là, les acteurs peuvent être déterminants. Cape est tout autant guidé par eux, par ce fermier improbable et cette jeune femme qui n’a rien d’une nymphomane. Il ne s’agit pas de leurs visages d’acteurs, mais bien des personnages qui s’incarnent peu à peu sous une lumière immatérielle : de face, toujours de face, qui est la lumière de l’arrêt, l’image de la mort
Les choix de Cape corroborent ceux de Bruno Dumont. Ça fait couple. Ça tient, du début à la fin. Je ne m’intéresse pas beaucoup ici au symbolisme des couleurs, car j’y entends finalement peu de choses. J’y cherche davantage, dans la récurrence des plans, des cadres, et des points de vue, et le rôle liant de la lumière, ce qui de tout cela nous restitue du réel. Il existe un article très intéressant de Caroline Champetier sur cette question , à propos de la nudité au Cinéma. C’est « éclairant » ce qu’elle évoque, de cette lumière qui peut voiler la réalité. Il faut voir comment dans le film de Bruno Dumont, qu’elle soit d’hiver ou de printemps, comment cette lumière est une absence : tout prend corps pour que tout s’arrête, à chaque fois, sur chaque plan. Aucune possibilité d’y échapper. Pas d’ombre, parfois de la pénombre mais une lumière toujours cadrée, encadrée, contenue. Ainsi, pour en proposer un exemple, la séquence où les quatre se retrouvent à brûler des branches d’arbre, en buvant de la bière. Là où beaucoup auraient pu vouloir accentuer l’éclat du feu, Yves Cape « choisit » de contenir les visages dans une lumière crépusculaire. Seul le traitement des scènes de guerre, partage le film, tant par le choix du support, que par le traitement d’une dominante de couleur différente. Rien pourtant ne nous ramène à autre chose, un autre film, un paysage déjà vu. Nous restons dedans, pendant toute la durée de la projection, nous y sommes collés. Bruno Dumont filme la matière, une ecchymose sur un bras, un collet posé, des branches d’arbre, un sexe féminin vite voilé, alors qu’un sexe masculin plus loin est mutilé, il filme cela en des entités de plans, qui se renvoient d’un bout à l’autre du film, dans cette même cohérence, un principe de parité, de plans qui fonctionnent à deux, pas forcément collés l’un après l’autre, deux visions subjectives sur le ciel, deux intérieurs de maison de la fille, deux paysages lointains... etc. Sans aucun didactisme. Là s’engage l’idée d’une structure, d’une chaîne de signes/plans se renvoyant de l’un à l’autre, et qui fondent un langage cinématographique. Peu de métaphores par le montage, peu de recours à des correspondances métonymiques : ce langage est sec, cru, arythmique, à l’image de la psychologie des personnages. Ce point nécessiterait un développement à lui seul.
L’imaginaire, lui, se ramène à peu de choses. A ces gens-là, on a raconté peu d’histoires, et la vie s’écoule ainsi, d’un réel qui leur fait peu d’effet : ils passent à côté, ne l’envisagent pas, sont dedans eux aussi. Prendre une femme, c’est donc fendre la terre avec un engin. C’est faire un trou dedans. Il faut que ça soit droit, que ça aille vite. Gros plan sur les lames de la charrue. Entre hommes, ça imagine un peu plus. Le collectif, ou d’être au moins deux, ça introduit le fantasme, et fonde l’image : la guerre ça va être ça, on va faire ça... On va être des hommes. Un homme, pour eux, c’est comme ça. Tout fonctionne ainsi sur ce registre aride, asséché. Le fermier improbable n’imagine rien de ce que peut ressentir la femme, et pour elle, c’est pareil. Cela ne veut pas dire qu’ils ne ressentent rien. Mais de s’imaginer l’autre leur est d’emblée impossible, car l’autre n’est qu’une image prise dans le réel, insérée dedans, fondue et prise comme telle, la jeune fille, dans un cadre, toujours le même, toujours au même endroit, toujours au même moment de la journée. Le cadre, c’est Bruno Dumont qui le crée pour raconter ça. Et du cadre justement, il ne nous laisse aucune possibilité d’imaginer autre chose. C’est le plus souvent fixe, mais surtout, ça n’entre pas et ça n’en sort jamais, ou très rarement. Plutôt ça s’éloigne, les personnages s’éloignent dans le champ de la caméra, dans les champs des Flandres. Pas d’en-dehors possible, c’est dire peu de moyens d’imaginer autre chose. L’art de Bruno Dumont, c’est de nous mettre à la même place que ses acteurs et ses personnages, sans aucune possibilité d’y échapper. Nous sommes dans le réel de la salle, hypnotisés par les visages filmés en gros plan, leur regard décentré, la blancheur de la peau de cette jeune fille... Les visages en ressortent, iconographiés.
Enfin, vers la fin du film, quelque chose apparaît. Il est rentré seul de la guerre. La jeune fille « devenue » un peu folle et sa copine le regardent. Elles hésitent, puis la copine se décide alors à aller voir le garçon.
C’est là que, peut-être, l’Humanité commence, sur un tas de bois. C’est là que quelqu’un, pour la première fois, demande à ce qu’on lui raconte une histoire, aussi cruelle soit-elle. C’est de la mort dont il sera question, celle du compagnon, innocent mais châtié, castré pour expier dans un raffinement ultime de la vengeance, la première faute du fermier : celle d’avoir violé une femme pendant sa petite guerre. La jeune fille, la folle, qui ne sera jamais comme sa mère, car elle est toujours fille, s’emporte dans une crise de folie : ce qui tout d’un coup lui devient insupportable, que l’on commence ainsi à se raconter des histoires, et qu’une humanité est peut-être ainsi en train de naître, elle qui n’a pas voulu l’enfant, et pourtant ça va naître, et rien ne sera plus comme avant... Il va falloir apprendre à parler. Ils sont allongés l’un sur l’autre. Parce qu’il se résout à avouer, elle lui pardonne sa deuxième faute : celle d’avoir abandonné dans sa propre fuite, son compagnon de guerre et de sexe. Ils ré-inventent alors dans leur solitude, la possibilité d’une rédemption. Ils commencent à nous/se faire croire à quelque chose. C’est la seule fois dans le film que « Dieu », ou un ordre semblable, semble évoqué. Ils se déclarent leur amour, l’amour du prochain quand Adam est le fermier et Eve fait la folle.
Ainsi se termine le film. A ce que l’on peut y voir comme une fin plus rassurante, se devine quand même tout ce qu’il reste d’Humanité à parcourir. En ce sens, « l’Humanité » de Bruno Dumont semble faire suite, à celui-là. Et la frayeur sera d’un tout autre ordre...
 En
En Fr
Fr