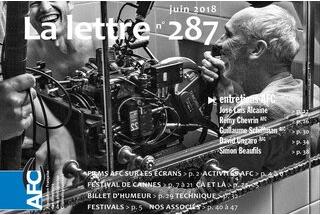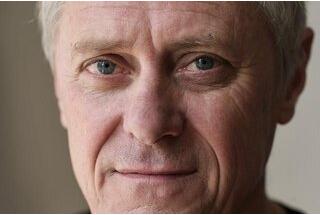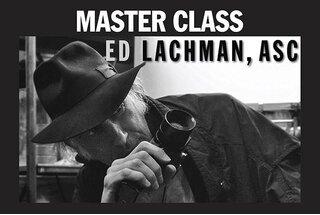Lettre d’une intermittente
Cher Monsieur Ralite,
Vous entendre m’a bouleversée car vous m’avez redonné un peu de dignité. Vos mots, votre pensée, cette phrase « Je porte plainte », je peux me les approprier.
Je suis une jeune monteuse. Cela fait plus de dix ans que je tente de trouver ma place dans ce milieu professionnel très fermé. J’ai travaillé avec de grands metteurs en scène, et d’autres moins connus. Depuis quelques années, pas un jour ne passe sans que je me demande : « Pourrai-je encore exercer mon métier l’année prochaine ? »
Faire des stages non payés pour arriver à se former et, peut-être, à intégrer une équipe, ne pas partir en vacances de peur de rater un contrat, ne jamais savoir de quoi la semaine prochaine sera faite, ne pas faire de projets, sans répit entretenir les contacts pour agrandir un réseau professionnel fragile, subir la pression et le pouvoir exercés par les employeurs car le travail est cher et rare et de nombreux postulants « attendent derrière la porte », être flexible, ne pas compter les heures, travailler la nuit au tarif jour, les dimanches au tarif semaine, accepter de travailler sur des films bénévolement ou, dans le meilleur des cas, " en participation " (salaire versé sur les recettes du film après complet remboursement du producteur), ne recevoir son contrat d’engagement qu’une fois le travail effectué, c’est-à-dire travailler sans filet, sans protection, être éjectable sans délai et sans conditions, essuyer le refus des propriétaires pour la location d’un appartement et celui des banques pour l’obtention d’un prêt parce qu’on est intermittente... Voilà notre lot. Et je ne parle même pas de la retraite !
Tout cela, nous y sommes confrontés, nous le combattons, et pourtant nous cherchons à avancer, à inventer, à préserver le plaisir de notre métier.
Une monteuse a dit au colloque que travailler sur des films documentaires, parfois peu financés, mal payés, c’était un choix. Une liberté, notre liberté. C’est cette liberté que nous payons toutes et tous, au prix fort.
Personnellement, depuis des années, je me sens en sursis. Et au-delà de la vie professionnelle, cette précarité pèse au cœur même de mon intimité. Cette insécurité permanente, quotidienne, que nous portons en nous depuis trop longtemps, laisse des traces indélébiles, des cicatrices visibles et invisibles. Nous sommes à bout. Comment en est-on arrivé là ?
(Le Monde, 16 août 2003)
 En
En
 Fr
Fr