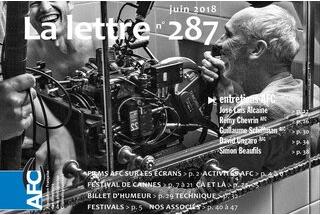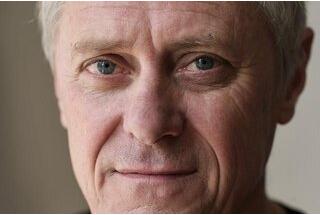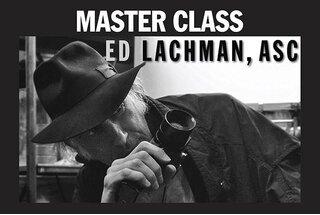Paolo Carnera, AIC, partage son expérience en Zeiss Supreme Prime
Paolo Carnera : J’ai rencontré Ramin Bahrani il y a trois ans, quand il m’a contacté pour tourner le pilote de "Treadstone" (série dérivée de la saga Jason Bourne), après avoir vu Gomorra. C’est un réalisateur intéressant, qui a commencé sa carrière dans le cinéma indépendant (Chop Shop, 99 Homes) traitant des injustices sociales, et qui essaie maintenant de se tourner vers le grand public, tout en conservant cet engagement. Il m’a donné à lire le roman et le scénario pendant que nous tournions à Budapest. Les huit semaines de préparation ont commencé en septembre 2019 et le tournage a duré dix semaines. J’ai passé au total quatre mois en Inde, un pays pétri de contradictions que j’ai sincèrement beaucoup aimé.
La caméra et les optiques venaient d’Italie ?
PC : Je voulais tourner en Alexa et, pour répondre à l’exigence de 4K de Netflix, heureusement que la LF venait de sortir. On a même pu avoir deux Mini LF. On aurait pu louer à Londres mais, à Rome, nous avions la possibilité de faire une semaine d’essais avant de partir. Andrea Grossi (cadreur et opérateur Steadicam), Fabio Ciotto (1er assistant opérateur), Francesco Scazzosi (DIT) et moi formions la petite bande d’Italiens parmi l’équipe indienne, plus le réalisateur qui est irano-américain, Urs, le 1e assistant réalisateur, allemand, Chad, le chef décorateur, américain, et Paul Ritchie, producteur associé, anglais.

Comment le réalisateur et vous avez échangé sur vos intentions artistiques en préparation ?
PC : Nous avons partagé beaucoup d’images de référence, y compris pendant le repérage qu’il a commencé avant que je le rejoigne en Inde, puis avant et pendant le tournage. On a regardé certaines scènes dans des films qu’il aime, comme Taxi Driver et d’autres films de Martin Scorsese. Beaucoup de mouvements de caméra viennent de notre visionnage des Affranchis. J’ai aussi revu le film de Ramin, GoodBye Solo, dont le personnage principal est aussi chauffeur, et nous avons parlé des séquences de voiture que j’avais tournées dans Gomorra.
En termes de look, la structure de l’histoire était constituée de trois parties : la première est le passé de Balram, le protagoniste ; dans la deuxième, il devient chauffeur ; et la troisième est son succès en tant qu’entrepreneur. L’image de la première partie, pendant l’enfance de Balram au village, devait être simple et réaliste, mais aussi jolie et agréable. C’est un monde pauvre mais toujours digne. Les règles familiales sont dures, mais il y a de la beauté dans les visages. Ensuite, dans la grande ville et la maison des maîtres, Balram découvre un monde plus propre. Il est heureux mais il comprend aussi que pour monter en grade, il va falloir être aussi dur que ses maîtres. Nous voulions que ce soit plus blanc, distinct de la chaleur du village : tout est propre, mais aussi froid. Et enfin on arrive à la ville flamboyante, la maison d’Ashok et la confusion de Delhi. La réussite finale du protagoniste prend place dans un monde de couleurs, un peu trop de couleurs même, parce que c’est toujours trop : le Balram qui a réussi aime le kitsch, c’est comme ça.

J’ai toujours aimé les couleurs et les lumières de l’Orient, d’Afrique, d’Amérique du Sud. Quand je suis arrivé à Delhi, j’ai été attristé par les LEDs blanches qu’ils utilisent partout. Il n’y a plus de couleurs, toutes les boutiques se ressemblent. Dans mes souvenirs, la nuit était pleine de lumières bleues, vertes, jaunes et rouges… Pour illustrer les différents tons de l’histoire, d’une part une comédie légère et de l’autre un drame satirique, on a beaucoup joué avec les codes du genre, les couleurs et les contrastes. Par exemple, j’ai ajouté toutes les lumières colorées du marché de Delhi. Pareil dans le sous-sol où vivent les chauffeurs.
Ce sous-sol existe dans la réalité ?
PC : J’ai eu la même philosophie que pour Zero Zero Zero et Gomorra : j’étudie la réalité telle qu’elle est, j’en vois les choses les plus fortes, et si elles ne sont pas dans mon cadre, je les y mets. Dans The White Tiger, j’ai essayé de reproduire et d’exacerber ce qu’on voyait dans la réalité. En repérage, on a visité un sous-sol où, d’un côté il y a avait toutes les voitures, et de l’autre, des messieurs qui faisaient la lessive et le repassage des maîtres. C’est un beau monde, plein de vie, avec des gens qui travaillent sous le sol et d’autres dans des buildings. Le film ne parle pas seulement des différences sociales. Il raconte qu’il est impossible, toujours, de changer de caste. Pour changer de caste, Balram doit commettre quelque chose de terrible. Le film est à la fois drôle et bouleversant.
Avez-vous parlé de la question du réalisme avec le réalisateur ?
PC : Oui, c’est le point de départ de beaucoup de scénarios. La plupart des spectateurs ont besoin de reconnaître ce qu’ils voient ou, s’ils ne connaissent pas l’Inde, de croire à la possibilité du monde du film. Alors on ajoute des nuances d’irréalisme dans le réalisme. Parfois on est doux, drôle, dramatique, d’autres fois on est très sombre et profond, et tout coule dans la même rivière de réalité, améliorée pour donner des émotions au spectateur. Par exemple, pour les scènes de nuit en voiture, on ne pouvait pas filmer dans les belles rues de Delhi parce qu’on ne pouvait pas bloquer la circulation (il n’y a pas d’autre rue, on ne peut pas prendre de déviation comme à Rome ou Paris). On ne pouvait pas non plus tourner dans la vraie circulation, parce que nous avions des stars. On a dû recréer la circulation dans des rues que nous pouvions contrôler, hors de la ville, dans des quartiers sans aucun éclairage. Pas de lampadaires, pas de vitrines, rien. Les couleurs qui arrivent sur les visages des acteurs viennent de projecteurs LED accrochés tout autour de la voiture, que je contrôlais depuis une autre voiture via un iPad. Je changeais les couleurs pour qu’on ait l’impression qu’ils étaient au milieu du trafic de Delhi. On ne voulait pas filmer sur fond vert, pour nous comme pour les acteurs, alors nous avons fait un mélange de reconstruction de la lumière comme on fait en studio, et de tournage en décor naturel. C’était compliqué et intéressant !

Et la texture de l’air en Inde ? Est-ce qu’il y a quelque chose de "différent" dans la lumière ?
PC : J’attendais cette question… (rires). Je suis arrivé après la saison des pluies. C’est beaucoup plus facile de tourner à la saison sèche ! Agra et la campagne étaient magnifiques, le soleil était doux, le ciel clair, c’était une joie de tourner là. Nous avions l’impression de ressentir l’atmosphère traditionnelle de l’Inde. En revanche, New Delhi est immense et son niveau de pollution est énorme. On ne pouvait pas voir le soleil. En saison sèche, la pollution atmosphérique augmente. On a commencé à utiliser des masques trois mois avant la pandémie de COVID à cause de la pollution, certains jours ça nous brûlait les yeux. La plupart du temps le ciel était blanc et la lumière laiteuse était difficile. J’essayais de la modeler quand c’était possible mais sinon j’étais obligé d’assumer cette atmosphère, de jouer avec. Le brouillard tombait au crépuscule mais j’adorais ça ! J’aime beaucoup l’atmosphère brumeuse et mystérieuse de la scène du meurtre. En outre, quand on filme un scénario avec autant de décors, on va sur plusieurs décors par jour, et à chaque fois ça veut dire une ou deux heures de trajet : il faut être très organisé et on ne peut pas perdre de temps à éclairer. De plus Ramin voulait un montage très serré et certaines scènes ne duraient qu’un 8e de page, avec plusieurs axes caméras. Et il ne veut pas attendre… C’était un jeu entre nous, je devais travailler vite, chaque décor devait donc être prêt à l’avance. Les repérages techniques étaient cruciaux, et j’ai eu la chance de rencontrer Rubb Bhungdawala, mon gaffer, qui était très attentif et savait comment pré-lighter les décors, avec sa très bonne équipe de jeunes électriciens, dont une partie ne parlait pas anglais. L’équipe était énorme, c’est la première fois que j’avais dix-huit électriciens ! C’est grâce à Rubb qu’on a pu tourner sur tous ces décors.
Pourquoi avez-vous choisi les Supremes Prime ?
PC : Comme je le disais, on n’avait qu’une semaine pour faire des essais à Rome avant de partir. Je savais que j’allais avoir besoin de grandes ouvertures, parce que nous allions filmer avec la lumière naturelle de la ville. J’ai trouvé que les Supremes parvenaient à un équilibre entre l’esthétique du film et la luminosité dont j’avais besoin. Ils ont aussi une très bonne réponse chromatique. Ils sont piqués sans être durs, et je savais que ça allait aussi être un film à propos des visages. Le paysage d’un directeur de la photo, ce n’est pas seulement la ville ou la campagne mais aussi les visages des protagonistes. Il doit les respecter et gagner leur confiance. C’est très important de réussir à entrer en contact avec les acteurs, et qu’ils aient confiance en ceux qui enregistrent leur visage et leurs émotions, avec sensibilité et humanité. Il faut un matériel qui permet de donner au spectateur les émotions qu’on a ressenties au tournage, en regardant jouer les acteurs.
On devait aussi décider de choisir un ratio panoramique ou non. De toute évidence, les Supremes ont été conçus pour tous les ratios : il n’y a pas de perte de piqué ou de luminosité dans les coins de l’image. Parfois j’aime tourner avec des optiques vintage, je change pour chaque film, mais le format large ne me laissait pas beaucoup de choix à ce moment-là. J’ai été très heureux de tourner avec les Supremes. De nuit, à pleine ouverture comme je pose tout le temps, ils sont magnifiques !
Ramin aime faire de légers zooms avant pendant les travellings et sur les plans au Steadicam, on a donc complété avec des zooms Angénieux Optimo EZ 22-60 mm et 45-135 mm, pour leur légèreté et la manière dont ils raccordent avec les Supremes.

Vous saviez déjà, en préparation, que la caméra serait aussi près des visages ?
PC : C’était une possibilité, cette manière d’utiliser les focales courtes avec le format large est intéressante. Ramin l’a utilisée de plus en plus au fil du tournage, pour soutenir l’idée d’une déformation psychologique progressive dans le cauchemar que vit Balram, pour entrer dans ses émotions.
Les retours que nous recevons de tout autour du monde sont très forts. Mon travail, c’est de faire de bons films avant tout. Si je fais de belles images pour un mauvais film, je suis perdant. Si je fais des images puissantes pour un bon film, c’est une réussite. C’était mon travail avec Ramin. Pour être un bon directeur de la photo, je dois procurer une émotion au spectateur, c’est toujours ce que je vise.
 En
En
 Fr
Fr