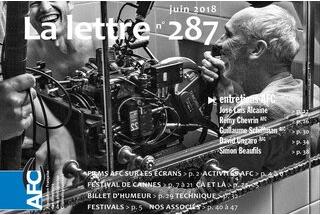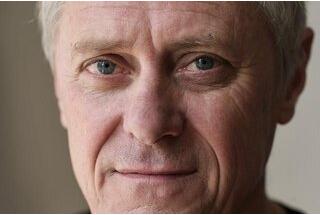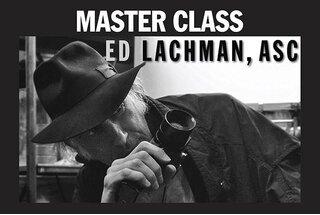Rencontre avec Bruno Delbonnel, AFC, ASC, à la Cinémathèque française, autour du "Faust", d’Alexandre Sokourov
Lancé sur la genèse du projet et la production du film, Bruno Delbonnel avoue que le tournage de Faust n’était pas le plus simple qu’il ait connu...
«Le film était un gros projet pour Sokourov... Une superproduction de 3 millions d’euros, alors que la plupart de ses films précédents s’étaient financés pour moins de 500 000. Le Kremlin lui-même ayant levé une partie des fonds pour boucler le budget. Comme il n’y a presque pas d’architecture en pierre en Russie et que l’Allemagne (transposée dans Faust) était trop chère pour le film, nous sommes allés tourner en Tchéquie, de manière à trouver des villages locaux qui puissent passer pour des villages allemands. On s’est donc retrouvé à côté de Prague, avec une équipe en partie tchèque, et en partie russe. J’étais le seul Français sur le plateau, et c’était un peu compliqué entre les Russes et les Tchèques. Lors de la préparation, je me souviens, qu’en plein mois d’août, un feu d’artifice est soudain tiré un soir... Et les Russes de demander aux Tchèques ce qu’ils célèbrent... Ces derniers de leur répondre avec aplomb "votre départ" ! »

Comme sur ses précédents films, le réalisateur russe est un fervent utilisateur de techniques de prises de vues amenant parfois l’image vers des déformations et des effets de perspective assez uniques. Bruno Delbonnel détaille :
« Alexandre Sokourov aime par exemple utiliser des objectifs étranges. La plupart de ces dispositifs étant directement amenés par lui sur le plateau. Sur Faust, on avait par exemple un système de prismes à fixer sur un objectif 50 mm qui bougent en même temps que la caméra panote... Et qui fait défiler les fonds tandis que le premier plan reste fixe. Ou un double bloc anamorphique frontal (déjà utilisé sur le film Mère et fils) qui permet de doser la distorsion d’image pendant la prise.

Il n’hésite pas aussi à tourner parfois à travers un grand miroir articulé (2 m par 1,2 m) ce qui permet de déplacer le point nodal de l’objectif. Ainsi, en pivotant le miroir, il crée des mouvements très différents en perspective de ce qui pourrait être l’équivalent en simple panoramique ou sur dolly. Enfin, il aime aussi tourner à travers des plaques de verre sur lesquelles il dispose de la peinture en mouvement. C’est une sorte d’immersion dans l’image. Une recherche de textures et de déformation qui lui est propre. Même sur les gros plans de comédiens, comme celui sur Marguerite, tourné avec un objectif expérimental de l’Armée rouge, la comédienne littéralement collée à l’optique. Au point tel qu’une petite tache plus sombre apparaît sur son nez, car il touche la lentille frontale !

Interrogé par Laurent Mannoni sur les influences et notamment le rapport avec le Faust, de Murnau, Bruno Delbonnel répond :
« Même si certaines séquences, comme celle d’ouverture, est clairement un hommage à Murnau, pour autant Sokourov n’est pas un grand amateur de cinéma. Lui, son truc, c’est plutôt la peinture ou la littérature... J’ai l’impression qu’il ne considère pas vraiment le cinéma comme un art majeur, même si c’est paradoxalement son langage. Par exemple, au sujet du format d’image, si on avait pu tourner dans un ratio vertical, évoquant la peinture, je pense qu’il l’aurait choisi. Mais il n’y a aucun format de peinture qui corresponde à ce qu’on a l’habitude d’utiliser au cinéma.
Sa grande idée sur ce film était de placer visuellement l’histoire dans un moment où le monde est en train de basculer... Faire flotter la caméra en permanence et revenir à l’origine du cinéma en terme de rapport d’image. Avec en plus des bords arrondis pour casser en quelque sorte la tension créée par les angles. Une tension qui autrement aurait détourné l’œil du spectateur de celle présente dans le film. Une manière de diriger l’œil au cœur de l’image selon lui... »

Quand on évoque dans sa filmographie le sixième épisode de Harry Potter tourné juste avant Faust, le directeur de la photographie assume pleinement ses choix :
« C’était marrant de se confronter à un film de 250 millions de dollars, et une équipe de 1 000 personnes. Les contraintes aussi, très stimulantes... Par exemple, avec les enfants comédiens, la loi anglaise étant extrêmement stricte et limitant le temps tournage pour eux à quatre heures par jour. C’était toute une gymnastique très complexe à mettre en place pour commencer avec eux, passer ensuite aux adultes, revenir sur tel ou tel décor... Et puis sur ce genre de film, vous avez absolument tous les moyens. Le décor du grand hall de Poudlard par exemple fait 60 m de long, avec 2 500 kW de lumière installée à demeure pendant six mois, au gré des allées et venues et du plan de travail. Un luxe incroyable ! J’avais même sur place une salle Baselight installée dans le studio où on tournait, ce qui me permettait, par exemple entre les prélights, d’aller superviser les premiers étalonnages... Je suis vraiment très heureux d’avoir pu le faire, même si c’est vrai, je n’ai pas souhaité faire les suivants... Sokourov m’appelant juste après et me proposant Faust.
Il faut le reconnaître, travailler avec Sokourov, c’est une aventure très différente du monde de Harry Potter. Une aventure assez extrême... D’autant plus que je ne parle pas russe, et qu’il ne parle ni anglais ni français. Toute la communication sur le plateau se fait via un interprète, avec en plus un réalisateur qui est un vrai poète.... Par exemple, il peut très bien vous décrire l’ambiance lumineuse d’une scène comme « un vol de mouettes au-dessus de vagues au moment où le soleil se couche ». C’est parfois très compliqué de savoir exactement ce qu’il veut, même si tout est story-boardé en amont... »

Prolongeant les comparaisons entre les différentes méthodes de travail, Bruno Delbonnel évoque aussi ses collaborations avec Tim Burton et les frères Coen :
« Moi, ce qui m’intéresse à chaque fois, c’est de comprendre un réalisateur, de rentrer dans son univers... Me comporter comme une éponge à son contact. Tim Burton, par exemple, est quelqu’un qui va très vite. C’est quelqu’un qu’on ne voit qu’un quart d’heure par jour maximum en prépa... Il faut lui poser des questions très directes, et guetter ses réactions. S’il attrape un crayon et qu’il se met à dessiner... c’est que c’est foutu, il ne vous écoute plus ! Pour autant, il reste très ouvert aux idées des autres, tout en gardant une sorte de territoire qui est le sien, sur lequel personne à vrai dire ne pénètre. Les suggestions qu’on peut lui faire vont éventuellement être retenues, puis être transformées en une idée à la Tim Burton. C’est assez magnifique ! Ensuite sur le plateau, c’est quelqu’un qui ne story-boarde pas du tout ses films, mais qui passe beaucoup de temps à répéter, et à mettre en place le découpage sur place.
Les frères Coen au contraire passent toute leur préparation à story-boarder très méticuleusement le découpage du film, à raison de trois à quatre heures par jour avec leur directeur photo. Ensuite, ils mettent ce document de côté, sans s’y référer forcément le tournage démarré. Ils savent dans quelle direction ils vont, mais tout est modifiable selon ce qui se passe sur le plateau. Le story-board devient pour moi un outil très intéressant quand on l’utilise comme ça. Les journées sont réglées sur le même modèle : une douzaine de plans par jour, avec un rythme soutenu, mais sans pour autant faire la course. Je me souviens par exemple du début de tournage à New York sur Inside Llewyn Davis, où on terminait la première semaine en avance vers deux heures de l’après-midi. M’attendant à voir les deux frères prendre de l’avance sur le lundi à venir, j’ai été assez étonné de constater qu’ils avaient déjà quitté le plateau pour partir en week-end !

Questionné sur son rapport à la musique qu’il met souvent en avant dans les entretiens, Bruno Delbonnel se livre sur ses influences :
« Ce qui m’a toujours étonné, c’est que les peintres parlent souvent beaucoup d’autres peintres, et se réfèrent à la peinture elle-même. Prenez Richter par exemple, un des plus grands peintres allemands contemporains, c’est quelqu’un qui est lié au médium même, et à l’histoire de la peinture, en avançant dans son art autour de ça. Nous, au cinéma, ce que je trouve assez déplorable, c’est qu’on ne se réfère pas suffisamment à l’histoire du cinéma. Il faut toujours qu’on aille voir ailleurs, comme si le cinéma n’était pas un art à part entière... ou un art pauvre. Moi, je puise vraiment mon inspiration dans le travail des autres opérateurs. Que ce soit Gunnar Fischer, qui a signé les premiers films de Bergman comme Le Septième sceau, ou quelqu’un comme Billy Bitzer, le directeur photo américain de D. W. Griffith... J’aime aussi beaucoup le travail du Russe Vadim Youssov sur Andreï Roublev, de Tarkovski... Une merveille ! Et puis, parallèlement à ces inspirations directes dans le cinéma, un jour j’ai découvert un livre du musicien Pierre Boulez sur le peintre Paul Klee. Ce dernier explique que quand les musiciens parlent de musique, c’est souvent très technique et forcément ennuyeux... Cherchant une manière différente d’aborder la musique, il va chercher la musicalité dans la peinture de Klee, et inversement. Moi je trouve ça passionnant d’imaginer - même si je ne suis pas musicien moi-même ! - aller chercher des rythmes dans un tableau ou des gammes chromatiques, qui pourraient plus ou moins être transcrites en notes, en rythme. Et Boulez parle très bien de ça...
On peut mettre en parallèle le travail sur le temps qui est pour moi évident cinéma, le fait par exemple de contracter, ou au contraire de le dilater au moyen du montage. J’aime citer par exemple la séquence finale des Affranchis, de Scorsese, qui va réellement à 200 à l’heure, ou en opposition le plan final de Nostalghia, de Tarkovski, très lent, au bout duquel on guette le moment où la bougie va s’éteindre... Mon envie d’associer le temps et le rythme à la direction photographique d’un film est donc partie de là, plutôt que de se référer traditionnellement à la peinture. D’ailleurs je ne me réfère plus du tout à la peinture figurative. Je m’en suis éloigné. Seulement parfois au travail de l’abstraction, comme celui de Pollock et de ses gouttes de peinture qui créent pour le coup un vrai rythme au cœur de l’œuvre... Autre passerelle d’inspiration pour moi, l’architecture. Comme le musée Gugenheim de Bilbao, la fondation Louis Vuitton qui créent l’idée d’un rythme, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.
Basculant sur le thème du numérique, et sur son statut de pionnier depuis ses débuts en long métrage, le directeur de la photo revendique : « Je considère que les possibilités offertes désormais par l’étalonnage numérique font partie intégrante du travail du directeur photo sur un film. Depuis Amélie Poulain, qui était l’un des premiers films à bénéficier de la chaîne de postproduction numérique (avec retour sur film argentique ) j’ai travaillé principalement avec deux grands étalonneurs : Yvan Lucas et maintenant Peter Doyle. Ces deux personnes sont bien au-delà du simple coloriste. Un vrai dialogue s’instaure avec eux sur le film, c’est à leur contact qu’on arrive à l’image finale. Pour moi, c’est une manière de dire que c’est l’objet final qui est important - et pas la manière d’y arriver. On peut faire à ce sujet l’analogie avec les notes des grands photographes américains comme Richard Avedon ou Ansel Adams. Ils donnaient une multitude d’instructions à leur tireur, zone par zone, pour arriver au résultat final. Certes, on était à l’époque en argentique, et on ne pouvait que assombrir ou éclaircir telle ou telle partie de l’image... Des réglages rudimentaires par rapport à ce que le numérique nous permet aujourd’hui de faire, mais pour moi, l’intention est la même. Et je partage entièrement cet avis avec Emmanuel "Chivo" Lubezki, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler sur le nouveau film d’Alfonso Cuarón. Chivo est un grand manipulateur d’images lui-même et faire ce genre d’opération en postproduction n’est pas synonyme de recréer la lumière d’un film entièrement. C’est là qu’on va chercher la puissance de l’image - j’entends par là puissance émotionnelle plutôt que puissance esthétique. Un peu comme un coup de cymbale au milieu d’une symphonie !
Relancé sur les caméras et ce qui a changé pour le directeur de la photo, Bruno Delbonnel avoue :
«En fait la seule chose qui ait réellement changé sur les plateaux, c’est qu’avant on pensait que les chefs opérateurs avaient un secret. Ce secret, c’était d’être à peu près les seuls à savoir ce qu’on faisait... Moi je l’ai expérimenté sur Harry Potter, par exemple, faire une nuit avec 2 000 kW de lumière, avec le producteur à côté qui vous regarde en disant : « Mais t’es sûr de toi Bruno ? C’est une nuit dans le scénario... c’est pas du plein midi ! ». Ce en quoi c’est normal quand on a besoin de 8 de diaph pour voir dans la profondeur de la nuit... Et bien ce secret-là a disparu.
C’est fini, puisqu’on se retrouve à décortiquer en direct l’image sur des écrans Dolby à 50 000 €. Ces machines sont des avions de chasse, on peut y visualiser en direct le moindre écart, le moindre tiers de diaph en moins ou en plus... Et si vous avez un producteur qui a envie de vous ennuyer, et bien il va le faire... Car il sait exactement ce qu’il aura à la fin. Pareil pour le réalisateur.
Autre évolution récente, l’amplitude extraordinaire de pose atteinte par les caméras numériques. En testant la toute nouvelle caméra Alexa 35 sur mon dernier tournage avec Emmanuel Lubezki, on s’est aperçu que la latitude de pose atteignait presque 19 diaphs... C’est perturbant, car plus que l’œil humain n’est capable d’encaisser. Pour vous dire, on s’apprêtait à tourner une séquence au crépuscule avec Cate Blanchett qui marchait dans la rue. En ayant tout préparé pour être prêt alors que le soleil se couchait... Finalement, j’ai pu faire l’expérience de continuer à tourner quasiment à la nuit tombée, soit près de 2h30 après les premières prises de la scène faites… à 16 de diaph ! Mon cerveau ne comprend plus rien. La cellule devient complètement inutile, et on doit faire confiance à l’électronique - au demeurant allemande, donc très fiable !»
(Propos recueillis lors du dialogue animé par Natasza Chroscicki (Arri) et Laurent Mannoni (Cinémathèque française) et retranscrits par François Reumont, pour l’AFC)
 En
En
 Fr
Fr