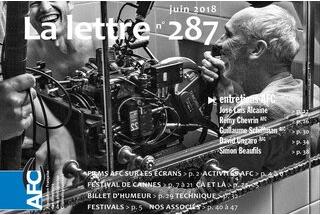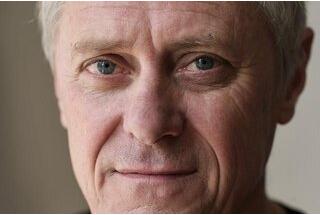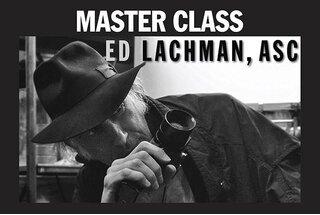"En Corée du Sud, on achève bien l’exception culturelle"
Par Philippe MesmerCe fut l’une des grandes montées de fièvre d’un printemps qui, pour le cinéma français, n’en manqua pas. La négociation d’un nouvel accord de libre-échange entre l’Union européenne et les Etats-Unis, débutée en juin, a ravivé le débat sur " l’exception culturelle ", cette notion selon laquelle la culture ne peut être abandonnée aux seules règles du marché.
Malgré les réticences des Allemands et des Anglais, la France a obtenu que la culture – et en premier lieu le cinéma, très concerné – soit écartée du champ des négociations. Lors de l’intense campagne de lobbying, le camp tricolore a agité le cas d’un autre pays chantre de l’exception culturelle, lui aussi dans le viseur des Etats-Unis : la Corée du Sud, où la production cinématographique est depuis longtemps protégée.
En 1967, le gouvernement sud-coréen a mis en place un système de quotas imposant de produire trois films locaux pour avoir le droit d’en diffuser un étranger. Par la suite, les salles ont dû programmer 146 jours par an des longs-métrages financés localement. Mais Séoul prend conscience de l’importance de l’industrie culturelle quand le président Kim Young-sam, en poste de 1993 à 1998, réalise que les recettes du film Jurassic Park équivalent à la vente de 1,5 million de voitures Hyundai.
Puis, de 1998 à 2008, du temps du président Kim Dae-jung et de son successeur Roh Moo-hyun – qui voulait que la Corée rejoigne les « cinq premiers pays de l’industrie culturelle » –, les subventions pleuvent. Le réalisateur Lee Chang-dong, bref ministre de la culture en 2003-2004, tente même de mettre en place un système d’aide similaire à celui existant en France. Un régime d’intermittents du spectacle est créé. Faute de moyens, ces mesures n’ont pas eu les mêmes effets qu’en France, mais elles ont favorisé l’émergence de réalisateurs talentueux, invités dans les grands festivals internationaux, tels que Bong Joon-ho (The Host, 2006), Hong Sang-soo (In Another Country, 2012) ou Kim Ki-duk (lauréat du Lion d’or à Venise en 2012 avec Pieta).
En 2012, 140 films ont été diffusés dans les salles coréennes, générant 438,4 milliards de wons (295 millions d’euros) de recettes. Mais, aujourd’hui, la place est aux grosses productions. « Depuis un certain temps », regrette Nicolas Piccato, patron de Panda Media, société de consulting de Séoul spécialisée dans les médias, « il y a moins de films sud-coréens dans les grands festivals. »
Beaucoup attribuent cette évolution à l’accord de libre-échange signé en 2007 avec les Etats-Unis et entré en vigueur en 2012. Les négociations ont pu débuter en 2006 car Séoul a cédé aux exigences de Washington, qui a conditionné les pourparlers à la baisse à 73 jours des quotas de diffusion des films sud-coréens. La décision a débouché sur des manifestations massives, au coeur de Séoul.
« Jusqu’à l’accord de libre-échange, les chaînes coréennes devaient diffuser 25 % de productions locales », rappelle Kim Bo-yeon, directrice du Korean Film Council (Kofic), un organisme créé en 1973, dépendant du ministère de la culture. « Aujourd’hui, c’est 20 %. » En 2015, les géants américains auront le droit de détenir à 100 % des chaînes de télévision en Corée du Sud et auront accès aux systèmes d’aide. « Le véritable enjeu, c’est la Chine », estime Antoine Coppola, spécialiste du cinéma sud-coréen à l’université Sungkyunkwan. « Il y a beaucoup de coproductions sino-sud-coréennes et les Américains veulent leur part. »
La baisse des quotas a eu un impact. Selon le Kofic, la proportion des films coréens, qui représentaient 63,8 % du marché local en 2006, a chuté à 42,1 % en 2008, sous les 50 % pour la première fois depuis 1999. Elle est remontée pour s’établir à 59,6 % en 2012, avec des succès populaires comme Les Voleurs, de Choi Dong-hoon. « Les films produits dans l’année sont soit des films à gros budget, de plus de 10 milliards de wons », explique Yang Gi-hwan, président de la CDMI, une organisation défendant la diversité culturelle, « soit des " petits films " de moins d’un milliard de wons. » Entre les deux, rien. « On assiste depuis plusieurs années à une bipolarisation du marché », confirme Yi Jong-ho, de la petite société de production TPS. Là encore, l’accord de libre-échange est pointé du doigt.
Certains y voient pourtant une évolution naturelle du marché, amorcée dès le début des années 1990 avec la politique du président Kim Young-sam. Produit à 100 % par Samsung, Marriage Story, de Kim Eui-suk (1992), fut le premier long-métrage non financé par le gouvernement. En 1995, le géant de l’agroalimentaire CJ, lié à Samsung, se lance dans la production et la distribution cinématographiques avec comme slogan : « Pas de culture, pas de pays. »
Véritable conglomérat, l’entreprise domine aujourd’hui le secteur. « C’est un rouleau compresseur », note un expert. « Le groupe se développe en effectuant une intégration verticale, tout en développant des activités sur le câble et les télévisions sur Internet. »
D’autres sociétés ont suivi, comme Lotte, Showbox ou NEW. « Ces géants exercent aujourd’hui un pouvoir absolu », déplore M. Yang, laissant aux projets indépendants peu de marge de manoeuvre. Leur distribution se fait dans des lieux, tel Indiespace, trop rare. « Pour survivre », note Antoine Coppola, « les petites sociétés travaillent pour les grands conglomérats, notamment en tant que sous-traitants. » « Avant de commencer un tournage, il y a toujours une petite cérémonie », souligne le réalisateur Hwang Byeng-gug. « Autrefois, on priait pour faire un bon film. Aujourd’hui, on prie pour qu’il rapporte beaucoup. » Quant aux stars, ajoute un expert, « elles vont sur les grosses productions et renoncent aux projets indépendants, comme elles le faisaient avant ».
Le tout sur fond de relatif désengagement de l’Etat. Les festivals coréens ont perdu beaucoup de leur intérêt du temps de Lee Myung-bak, président de 2008 à 2013. Conservateur et proche des conglomérats, il a remplacé les directeurs des festivals par des fidèles, pas forcément amoureux des salles obscures. Et les budgets du Kofic, qui permettaient de faire émerger de nouveaux talents, ont fondu. Si bien que beaucoup de techniciens ne trouvent plus de travail et les jeunes cinéastes peinent à concrétiser leurs projets. A moins de sonner à la porte du géant CJ, qui vient de créer un département chargé de repérer les auteurs de demain.
(Philippe Mesmer, Le Monde, 2 août 2013)
 En
En
 Fr
Fr