Entretien avec Eduardo Serra
par Diane Baratier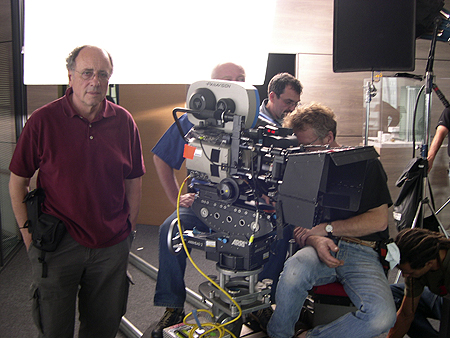
Diane Baratier : En ce moment, tu travailles avec Claude Chabrol, combien de films as-tu tourné avec lui ?
Eduardo Serra : Je crois que c’est le cinquième.
Votre collaboration évolue-t-elle au fil des films ?
E. S. : Très légèrement, Chabrol ce n’est pas la répétition, mais c’est un cadre très strict. La seule évolution, c’est une confiance qui s’est établie dès le début de notre collaboration. Pour lui, l’essentiel, qu’il ne dira jamais, est que la lumière ne constitue pas un poids. Je pense qu’il aime beaucoup travailler avec moi car je lui fiche une paix royale. Je me débrouille pour lui demander très rarement comment va être filmé l’ensemble de la scène parce qu’il déteste donner des renseignements à l’avance. C’est vraiment plan après plan. Il n’y a pas de découpage public mais il en a un en tête, susceptible de varier.
Par exemple, je me souviendrai toujours d’un acteur qui demandait s’il pouvait reprendre deux phrases plus tôt dans un dialogue pour se lancer. Et bien non, le plan commence à cette phrase-là et pas avant. Il a son montage en tête au moment du tournage et il ne couvre pas les deux axes.
Si je sens venir le piège, je lui demande comment il pense tourner le reste de la scène, mais cela se produit rarement. Je sais que pour lui l’essentiel, c’est qu’on ne l’embête pas, la photo ne l’intéresse pas.
J’ai eu récemment avec Chabrol une discussion à propos de Renoir et de la photo de ses films. On ne peut pas trop comparer Renoir et Chabrol mais dans les deux cas, la photo ne doit pas venir se mêler à l’histoire. Il faut que la photo soit discrète, propre si possible. Si elle peut apporter quelque chose au film tant mieux, mais il ne faut surtout pas qu’elle se voie. Elle n’est pas un outil. Il ne faut pas qu’elle puisse être un filtre pour le spectateur. La méthode de travail de Claude Chabrol est tellement subtile. C’est vraiment entre l’objectif 25 et 27, si c’est le 25 ce n’est pas le 27. De toute façon, Chabrol ne dépasse jamais le 50, s’il le sort c’est pour un insert, une fois par film. Il peut y avoir des mouvements d’appareil qui sont parfois des mouvements entre 50 centimètres et un mètre. C’est toujours d’une précision de position au centimètre près.
En général, il y a plusieurs personnes dans le champ. L’acteur n’est jamais isolé. Il a sa manière de cadrer laissant toujours beaucoup d’air au-dessus de la tête. C’est une obligation.
Tout cela a un côté fossile intéressant. Et c’est vrai qu’une photo forte le dérangerait.
Pour de nombreux réalisateurs, la photo est un élément de la narration ou un élément de la construction dramatique, mais pas pour Chabrol. Avant tout, la photo ne doit pas se voir, ne doit pas interférer ni dans la fabrication, ni à l’écran. Comme pour Renoir, pour qui la photo n’était pas spécialement intéressante, sauf par exemple dans La Règle du jeu, dans les scènes précises, un peu reportage, de l’aéroport ou de la voiture. Mais dans les scènes d’intérieur studio, la photo est banale. C’est correct, sans plus. Il semblerait que dans La Bête humaine, Renoir et le père Courant aient fait une photo à la " Carné ", une image où la photo vienne au premier plan, pour voir ce que cela donnait. Apparemment, Renoir aurait dit : « Plus jamais ça ! »
Si je comprends bien, avec Chabrol vous commencez la journée de travail sans que tu connaisses le découpage ?
E.S. : Oui. D’ailleurs, personne ne connaît le découpage, pas même son assistante, ni la scripte. Il déteste donner des renseignements. Autant il aime discuter, avoir du monde autour de lui, autant il s’énerve si on lui demande ce qu’il veut ou ce qu’il va faire dans l’heure suivante. Cependant, si, pour une raison précise, j’ai besoin de le savoir, il n’y a pas de problème, il m’explique tout, de manière claire. Chabrol veut sans doute se donner la possibilité d’évoluer en fonction de ce qui peut se passer et ne pas être coincé.
On ne sait jamais combien de plans il tournera dans la journée. Si on faisait une photo à risque cela serait impossible.
Alors il faut savoir se limiter. C’est un exercice de modestie. Parfois, sur certains films, il y a des opportunités, il y a une séquence où l’on peut se laisser aller et donner une tonalité à l’image. Mais entre les décors tout petits qu’on ne repère pas avant de tourner, les focales toujours larges ; il faut accepter que la moitié de la photo soit déjà faite avant d’arriver sur le plateau...
En même temps, avec Chabrol, il y a une élégance dans le personnage et la manière de filmer qui est réelle. Je suis trop jeune pour avoir pu rêver de tourner avec Lubitsch, mais c’est un peu la même chose, une autre manière d’utiliser les outils narratifs de l’image. Tu plonges dans un univers personnel de l’exploitation de la cinématographie et c’est très privilégié.
As-tu du plaisir à travailler avec lui ?

E.S. : J’éprouve à la fois du plaisir et de la frustration. Evidemment, c’est un plaisir. Je suis arrivé dans une équipe qui est une véritable famille. La moitié des gens travaille avec Chabrol depuis au moins trente ans. La scripte est sa femme, la première assistante est sa belle-fille. Quant à ses fils, il y a toujours un qui joue comme comédien et l’autre qui compose la musique. De fait, modifier un membre de cette équipe, cela revient à initier un tremblement de terre. Donc arriver là-dedans, c’est un peu... Je pense que j’ai été choisi par le chef machino, Dutreix, qui est mort entre-temps.
D’ailleurs, il y a une jolie coïncidence dans cette rencontre : pendant longtemps Chabrol a travaillé avec Jean Rabier. Or, le chef électro de Jean Rabier était le père Atanassian et donc se retrouver avec les enfants Atanassian qui sont mes électros, je crois que cela lui plaît beaucoup. C’est un peu la famille, une famille qui a des rituels.
Lorsque tu reçois le scénario, que fais-tu ?
E.S. : Je travaille beaucoup moins que d’habitude. Si je vois une opportunité comme sur le film précèdent La Demoiselle d’honneur, j’en profite. Pour ce film, il y avait clairement deux univers à définir : la normalité et la folie. Mais, sinon, il n’y a pas lieu de faire des constructions visuelles. J’en fais toujours de très discrètes bien sûr, mais dans le film que nous tournons en ce moment par exemple, je me limite à changer de pellicules.
Quand tu as préparé Jude, était-ce différent ?
E.S. : Cela ne peut pas être plus différent. Jude est un film qui va de l’enfance à la mort, à un désespoir total. C’est un film d’une noirceur incroyable, avec plusieurs périodes, plusieurs lieux qui se prêtent à découper visuellement.
Sur Jude, j’avais fait une construction que j’avais proposée au réalisateur, elle lui avait beaucoup plu. Nous l’avons retravaillée ensemble.
Nous avons fait une construction dramatique en jouant sur la position du Key light, le contraste, la couleur, la pellicule et le traitement labo. On faisait évoluer ces paramètres en fonction du sens dramatique de la scène. On jouait sur le Key light : du contre-jour flatteur au 3/4 dos amochant Kate Winslet.
La couleur variait du doré au bleu désaturé.
La pellicule à l’époque allait de la Fuji très photogénique à la Kodak très dure ; on passait du développement normal à deux niveaux de sans blanchiment. Pour un résultat plus appuyé, on a fait une partie de l’inter chez LTC, et une autre partie chez Eclair afin d’augmenter la progression.
Tout cela était prévu et écrit parallèlement au scénario, on avait le guide de la progression visuelle.
Sur les films américains, on a des réunions " the look of the movie meetings ". Nous sommes quatre ou cinq et nous discutons aussi bien du choix de la matière des vêtements, que des références visuelles de chaque scène, ou de la qualité des ombres.
Comme aux Etats-Unis, le directeur de la photographie a toujours un petit bureau pendant la préparation d’un film, je remplis les murs d’images. Je m’entoure toujours d’éléments visuels.
La période de préparation d’un long métrage américain est normalement de la moitié du temps de tournage, il y a des bibliothèques de référence pour préparer le film. Je fais des schémas de constructions et j’ai à ma disposition des tonnes de livres, d’œuvres cinématographiques, et d’éléments sur ordinateur en rapport avec le projet.
Tu veux dire des schémas de construction au sein de l’image même ou au sein de la séquence ?
E.S. : Non, au sein du film globalement.
C’est une architecture que tu construis par rapport au film ?

E.S. : Oui, l’essentiel, c’est cette structure. Si j’arrive dans un décor et que cela ne colle pas avec mon idée de la construction dramatique visuelle que j’ai fait approuver, je peux renoncer à un moment de beauté. C’est avant tout la ligne narrative qui m’intéresse. Qu’est-ce que chaque personnage représente ? Qu’est-ce que veut dire chaque scène ? J’essaye d’apporter ma participation au sens et à la crédibilité du récit, c’est ce qui me guide.
Dans La Jeune fille à la perle par exemple, es-tu resté fidèle à une structure qui correspondait au film ou as-tu essayé de travailler l’image comme une peinture ?
E.S. : La première chose que j’ai dite quand j’ai rencontré l’équipe de production, c’est qu’il ne fallait pas que le spectateur puisse dire : « Chaque image est un tableau ! ». Ça c’est la première chose.
C’est vrai que pour quelqu’un qui travaille à partir de la lumière naturelle, vraie ou fausse, mais la lumière logique, avoir une opportunité pareille, c’était un rêve. C’était vraiment extraordinaire et unique, sans parler de mon intérêt pour l’histoire de l’art.
Dès le départ, j’ai construit sur trois niveaux l’image du film en fonction des trois niveaux de la maison :
Le niveau du sous-sol qui est très très chaud, très rouge, un peu l’enfer, la soute.
Le niveau du rez-de-chaussée qui est le niveau fonctionnel de la maison normale, le lieu de la vie quotidienne.
Le niveau de l’atelier est le niveau de l’idéal, c’est le lieu où la beauté du monde est détachée des contingences du monde.
Les couleurs ne sont pas les mêmes. Il y a changement de pellicules entre rez-de-chaussée et atelier, et encore une autre pellicule pour les extérieurs.
Le décor suivait scrupuleusement ce que l’on sait de l’atelier, d’après les tableaux. Donc tout cela s’emboîtait automatiquement. Il y avait moins de choses à inventer que sur d’autres films comme Incassable, par exemple. On connaissait l’axe lumière, on connaissait le nombre de fenêtres. J’ai fabriqué en studio la fameuse lumière du nord qui est par définition sans soleil. On sait comment elle était, le tout était de jouer avec l’incidence et la position du personnage par rapport à la fenêtre. J’avais un angle de 30 ° pour choisir la place de mes sources. Ensuite, il s’agissait seulement de couper plus ou moins le mur du fond. Il n’y a pratiquement pas de lumière à l’intérieur tout au plus un poly avec une mandarine. Tout vient des fenêtres, comme la réalité.
Il ne faut pas oublier que ce qui était important à l’époque, c’était la reproduction. C’était un acquis récent. L’invention de la perspective, à la Renaissance, avait à peine cent ans, on n’en était pas encore à remettre en question la représentation. On en était à conquérir la possibilité de représenter.
Lorsque tu prépares un film, comment te documentes-tu ?
E.S. : Il n’y a pas de règle. Quand je suis en préparation, je dis de moi que je suis une éponge avec des antennes. Je me souviens très bien que pour Le Mari de la coiffeuse, tout s’est déclenché dans une rue de Lisbonne. J’ai trouvé la touche finale au dispositif que j’avais conçu en regardant le ciel.
Peux-tu me raconter ce dispositif ?
E.S. : Le décor en studio était une petite rue, et je ne souhaitais pas utiliser de space lights pour faire la voûte céleste, car je ne voulais aucunes ombres portées. J’avais opté pour 400 néons, mais la dernière touche, c’est en marchant dans la rue et en regardant le ciel que l’idée m’est venue. Il ne fallait pas mettre les néons au même niveau, mais les arrondir comme une voûte. Pour la scène sur la plage au début du même film, j’avais en tête des photos de Joël Meyerowicz à Cape Cod. Personne n’y pensera en voyant le film, mais moi oui.
Pour Les Ailes de la colombe, un film de Iain Softley, nous avons travaillé sur des tableaux de peintres vénitiens du XIXème. L’idée de départ a été de restituer Venise comme la porte de l’Orient ; à l’époque, cette ville populaire n’était pas au centre de l’Europe comme aujourd’hui, et elle n’était pas encore une ville musée. Afin de donner cette impression de doré, de chaleur, mais qu’il reste de la terre, du noir, j’ai opté pour un traitement sans blanchiment, et j’ai filtré en corail.
Je farfouille ainsi, parfois ce sont des sculptures qui peuvent être des références comme pour Incassable, aussi bien que des BD. C’est important non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour communiquer avec le réalisateur. On peut parfaitement ne pas parler de la même chose. Une image permet de savoir si on est d’accord. J’aime bien m’en entourer.
Toi qui tournes aussi bien en France qu’aux Etats-Unis, les rapports entre le directeur de la photographie et le réalisateur sont-ils les mêmes dans ces deux pays ?
E.S. : Tout est complètement différent. Les rapports ne sont pas du tout les mêmes. D’abord parce que la place de l’auteur n’a rien à voir. Le réalisateur n’est jamais l’auteur.
Aux Etats-Unis, l’auteur, c’est le scénariste. Le terme d’" auteur " ne peut s’appliquer à rien d’autre. Ils ont un respect du texte et du papier qui fait que les scénaristes sont très puissants. On ne peut pas changer une virgule du scénario ou du dialogue. Avec Robin Williams, qui improvise comme il respire, on avait l’obligation d’assurer au moins une bonne prise avec le texte exact.
Il y a des séances de réécriture permanentes entre le réalisateur, le scénariste et le producteur qui font évoluer les scènes et le dialogue. Mais tu ne peux rien faire sans l’accord du scénariste. L’auteur, c’est lui, point !
Après qui est à l’origine du film ? Qui en est le créateur ? Ce n’est jamais un réalisateur, c’est un producteur. C’est un type qui a l’idée d’acheter un livre et qui réunit une équipe. Le producteur est à l’origine du projet, il a choisi le réalisateur, le producteur est toujours sur le plateau, c’est le bras droit du réalisateur, c’est le conseiller, c’est l’autre regard. Ils ont un rapport très étroit. Jamais le producteur ne va parler à un acteur pour lui dire quoi faire ou placer la caméra, mais il est toujours là, assis à côté du réalisateur et ils discutent du sens et des choses. Le réalisateur est le premier des techniciens engagés par le producteur. Le deuxième est le chef déco, engagé plusieurs mois avant le directeur de la photographie. Ce n’est pas une question de pouvoir mais dans la mesure où ce n’est pas le réalisateur qui est tout et les autres qui ne sont rien, la donne est différente. Les chefs de poste ont des responsabilités. Ils n’ont certes pas de droits d’auteurs, mais ils ont une vraie place de collaborateurs.
Du coup, il y a un pied d’égalité avec le réalisateur.
E.S. : Non, mais effectivement dans le système traditionnel américain le chef opérateur avait beaucoup plus de pouvoir que le réalisateur.
Tu vas me dire Spielberg, Pollack, Eastwood sont des auteurs ! Oui, mais parce que leur capacité d’auteur est attachée au fait qu’ils sont producteurs et non pas au fait qu’ils sont réalisateurs.
Pollack et Spielberg, par exemple, produisent des films qu’ils ne réalisent pas, mais ce n’est pas en donnant seulement un chèque ! Ils produisent en aidant, ils sont à l’origine de l’idée. Ils la font réaliser par quelqu’un d’autre mais ils apportent leurs exigences et leur point de vue. Le créateur du film n’est jamais un réalisateur, c’est un producteur.
Ce système n’a rien à voir avec l’organigramme français.
Pourtant il fonctionne. Je ne comprends pas qu’on puisse ignorer qu’il y ait des rapports différents dans d’autres pays. Cela fait quand même presque cent ans que c’est ainsi et l’on devrait maintenant le savoir. Je pense qu’il y a une sorte d’impérialisme culturel français à refuser de voir ces différences.

Les photographies illustrant cet article sont de Diane Baratier.
 En
En
 Fr
Fr









