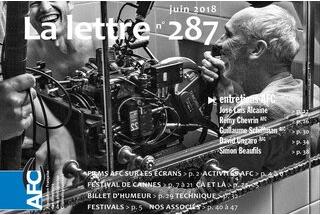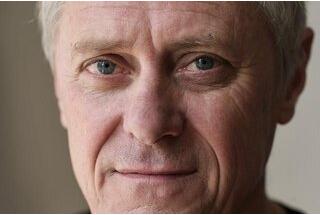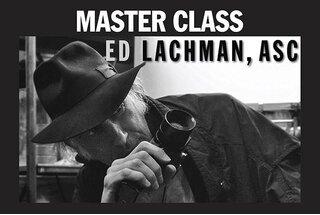Le monde secret de Philippe Rousselot
Par Bernard PayenLa chronique adolescente de Diane Kurys, Diabolo Menthe, y fréquente les primates de La Planète des singes (version Tim Burton), La Provinciale de Claude Goretta voisine avec L’Ours de Jean-Jacques Annaud. C’est également l’indice d’un succès durable pour Philippe Rousselot, ancien élève de l’Ecole Louis-Lumière, passé assistant caméra sur les films de Philippe Garrel et Eric Rohmer, et devenu quatre décennies plus tard directeur de la photographie de blockbusters américains. Cela dénote enfin un goût personnel chez celui qui, à l’adolescence, comprenant qu’il voulait faire du cinéma sans pour autant savoir encore ce qu’il ferait précisément de son désir, découvrait avec enthousiasme les films aussi différents de Jean Cocteau, Federico Fellini et Ingmar Bergman, sans oublier les films expressionnistes allemands dont on retrouve quelques traces formelles dans Mary Reilly de Stephen Frears, ou Entretien avec un vampire de Neil Jordan.
Une intensité des visages
« Cheveux bouclés, un visage aux traits fermement dessinés, il était mince comme un fil, musclé comme un serpent, et cachait sa nervosité sous un calme apparent (...) il parlait bien de l’image, était curieux, intelligent, doué d’une belle sensibilité artistique. » . C’est ainsi que Jean-Jacques Beineix se souvient de Philippe Rousselot dans ses Mémoires (1). L’association du cinéaste et du chef opérateur marque dans le cinéma français un retour à la prédominance d’une image « qui se voit », d’une esthétique singulière et très affirmée. Diva s’inspire notamment des monochromes bleus du peintre Jacques Monory et construit un Paris hyperréaliste et pop, rêvé par le jeune postier héros du film. La Lune dans le caniveau développe et amplifie ces partis pris artistiques. Son accueil au festival de Cannes sera très controversé mais permettra à Philippe Rousselot d’attirer davantage l’attention sur lui.
À partir de ce moment, il s’invente de film en film un monde entre réalité et fiction. Mieux, il réussit, loin du cliché du directeur de la photographie noyant son sujet dans la technique, la synthèse rare entre une esthétique élégante, raffinée, contrastée, et un attachement continu au jeu des acteurs, aux émotions infimes de leurs visages. En témoigne bien sûr Thérèse d’Alain Cavalier, dont le dépouillement lumineux de l’image renforce l’intensité des personnages. Deux années après la sortie de ce film, Philippe Rousselot formulait ainsi un précepte essentiel : « La lumière doit être la résultante de deux paramètres : comment les acteurs seraient-ils éclairés dans le décor en lumière naturelle et comment faire pour donner l’image qu’on veut avoir d’eux ? » (2).
Voir ce qu’il y a derrière un visage que l’on filme. C’est certainement l’ambition de tout chef opérateur. Rousselot y excelle si l’on prend par exemple Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, film sur le mensonge construit entièrement sur une symphonie des regards au cours de laquelle les personnages se cherchent et se tournent autour, loin des champs contre-champs usuels. De manière moins évidente à première vue, il y réussit aussi dans Trop belle pour toi en rendant bouleversantes les présences des acteurs, tout en privilégiant les plans larges et la distanciation voulus par Bertrand Blier.
Cadrer ou décadrer un simple dos immobile ou une démarche singulière suffit à faire éprouver l’attirance que se portent les personnages. Plus largement enfin, Rousselot a toujours su préserver l’épaisseur et l’humanité des personnages au cœur des films d’aventures (type La Forêt d’émeraude de John Boorman) et autres films d’action (Sherlock Holmes de Guy Ritchie) dont il a réalisé l’image.
Un monde secret
Même si Philippe Rousselot a un jour réalisé un long métrage (Le Baiser du serpent, en 1996, photographié par son grand ami Jean-François Robin), et donc assumé totalement cette fois-là un univers propre, on est tenté d’appliquer à son travail un principe poétique un peu fou selon lequel les chefs opérateurs construisent de film en film un monde personnel et secret. Dans celui de Rousselot, les contrastes rouge et noir de La Reine Margot de Patrice Chéreau, répondent à ceux d’Entretien avec un vampire de Neil Jordan, la brume où disparaît Mary Reilly à la fin du film de Stephen Frears, fait écho à celles qui densifient l’étrangeté de La Planète des singes de Tim Burton, les intérieurs boisés des maisons anglaises de Hope and Glory dialoguent avec ceux du Tailleur de Panama (deux films signés John Boorman), et les cadres précis et frontaux de Merci la vie de Bertrand Blier répondent presque à ceux de Thérèse d’Alain Cavalier. Plus encore, Flesh and Bone de Steve Kloves, tourné au Texas, apparaît sur le plan de la lumière douce et naturelle et de la simplicité du cadre, comme une réponse secrète et intime au travail réalisé par Nestor Almendros pour Les Moissons du ciel de Terrence Malick, établissant un hommage discret à celui qui pour Philippe Rousselot reste un maître.
Bernard Payen
(1) Les Chantiers de la mémoire de Jean-Jacques Beineix (éd. Fayard, 2006).
(2) Cahiers du cinéma n°395-396, mai 1987 (12 questions aux chefs opérateurs par Marc Chevrie et Frédéric Sabouraud)
 En
En
 Fr
Fr